Idées
La croissance zéro ou la grande stagnation
C’est un scénario à vous faire dresser les cheveux que présente le dernier ouvrage de Patrick Artus et Marie-Paule Virard: «Croissance zéro».
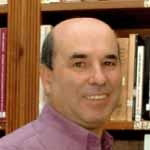
L’économie mondiale qui vit depuis sept ans une dépression persistante n’est pas prête de se relever. Son mal va durer encore quelques décennies. La question agite tous les beaux esprits de l’intelligentsia économique. Après avoir surfé ces deux derniers siècles sur la vague de la croissance, le monde s’installerait dans une période glacière. De nombreux facteurs contribuent à refroidir la machine: le vieillissement démographique, l’inefficacité des systèmes d’éducation, l’impact de la mondialisation sur le pouvoir d’achat, le coût de la lutte contre le réchauffement climatique, l’endettement public et privé, sans oublier la montée des inégalités, qui prive une majorité de la population des fruits de la croissance.
L’hypothèse de la «grande stagnation» ne peut être rangée au rayon des élucubrations farfelues de quelques économistes en mal de sensations fortes. Elle est explicitée par les travaux de la fine fleur de la recherche économique internationale, à commencer par Robert Gordon, Larry Summers, Paul Krugman. C’est qu’à long terme, la création de richesses dépend étroitement de la croissance de la population et du progrès technique. Or ces deux moteurs sont bel et bien grippés. La croissance de la population active marque le pas dans tous les pays développés, ce qui laisse craindre l’installation de ces économies sur un sentier de croissance plus bas. Quant au progrès technique, il ne cesse de donner des signes de ralentissement. En témoigne la stagnation de la productivité globale des facteurs (PGF) un peu partout dans le monde.
La PGF représente la capacité d’un pays à créer des richesses en combinant les facteurs de production (capital et travail) de la manière la plus efficace. Elle est le reflet de l’effort d’innovation et de l’amélioration du capital humain. Patrick Artus fait ressortir cinq causes à l’œuvre dans la stagnation durable. La première est relative à la perte d’efficacité de la recherche et développement ; les ambitieux budgets de la recherche ne débouchent plus sur la même quantité d’innovation. L’exemple emblématique est celui de la pharmacie : il faut aujourd’hui deux fois plus d’argent pour mettre sur le marché une nouvelle molécule. La seconde renvoie à l’augmentation de l’intensité capitalistique. Là encore, il faut désormais deux fois plus de capital qu’il y a cinquante ans pour créer la même quantité de richesses. La saga des majors pétroliers illustre ce phénomène ; ils doivent investir de plus en plus pour espérer extraire la moindre goutte de pétrole brut. La troisième cause s’explique par la diminution du poids de l’industrie dans l’économie et l’augmentation de celui des services. Cette tertiarisation de l’économie se traduit par des gains de productivité faibles. La quatrième est liée à l’insuffisante qualification de la population active ; le progrès technique réduit la sophistication moyenne des emplois, ce qui met en jeu à la fois le niveau de vie individuel et le potentiel de croissance collectif. La cinquième cause tient au fait que l’Internet ne serait pas une innovation majeure à l’instar de la charrue ou du moteur électrique. Les délais entre l’apparition de nouvelles technologies et les gains de productivité associés peuvent être très longs à se manifester. La stagnation du PIB sur une longue période sera donc l’enjeu crucial auquel la plupart des pays de l’OCDE seront confrontés dans les années à venir.
La baisse du niveau de vie s’installe avec l’augmentation de la précarité, de la pauvreté. La poussée des inégalités est sans précédent depuis les années 1930.
Ce contexte de crise appelle de nouvelles politiques susceptibles de s’attaquer à la racine du mal. Les anabolisants budgétaires et monétaires ne peuvent soigner l’économie réelle. Les politiques de l’offre sont nécessaires mais insuffisantes. Les réformes douloureuses ne seront supportées que si elles sont équitables. Faute de quoi on courrait le risque de voir exploser violemment les conflits catégoriels potentiels qui mijotent à feu doux. Aussi, la relance de la croissance passe par un nouveau partage de la richesse. Le partage salaires/profits pour redonner toute leur place aux revenus du travail. Un nouveau partage du capital/revenus du travail éviterait que l’appétit des investisseurs pour des rendements très élevés n’encourage la spéculation stérile. Le partage entre précaires/qualifiés pour remédier à la dualité du marché du travail en réduisant la protection de l’emploi pour les plus qualifiés, et en l’augmentant pour les plus jeunes et les moins qualifiés. Le partage prêteurs/emprunteurs pour protéger les emprunteurs de la catastrophe sans pénaliser les prêteurs (les épargnants). Le partage actifs/retraités en ajustant durablement, dans des conditions d’équité, le poids des retraites dans le PIB à la donne démographique avant que ne se produise la rupture du contrat intergénérationnel.
La thèse de la stagnation de longue durée, nouveau mal du siècle, doit être prise au sérieux. Les déséquilibres actuels d’un système épuisé par ses dérives constituent des sources de frustrations susceptibles de déboucher sur des conflits qui risquent de remettre en cause la vitalité de la démocratie. La thèse contraint à revoir en profondeur la manière de préserver le niveau de vie et de continuer à créer des richesses. Les pays occidentaux ne sont pas les seuls interpellés. Sont concernés aussi des pays comme le nôtre qui, aujourd’hui, réfléchissent sur l’évaluation de la richesse nationale, sur le rôle que peut jouer le capital immatériel dans la résolution des problèmes structurels qui handicapent la croissance potentielle et la recherche d’un modèle de développement plus efficient et plus équitable.
