Idées
La Cour et les finances
Il est navrant de constater que la présentation du rapport annuel de la Cour des Comptes par son Premier président devant les deux Chambres du Parlement a eu lieu dans un hémicycle à moitié vide
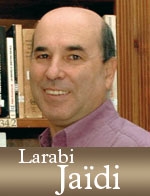
Dans les pays démocratiques, les rapports de la Cour des comptes ont un retentissement majeur dans les assemblées parlementaires, l’opinion publique et la décision politique. La Cour, forte de sa mission d’évaluation, prend position dans bien des domaines de la politique publique. Reprises avec force par les médias, les conclusions de l’institution comptable revêtent une puissance inégalée. Il est navrant de constater que la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes par son premier président devant les deux Chambres du Parlement a eu lieu dans un hémicycle à moitié vide. Pourtant l’événement est un rendez-vous politique majeur qui devrait renforcer les relations entre deux institutions dont les pouvoirs de contrôle et d’évaluation ont été étendus par la nouvelle Constitution.
Les relations que le Parlement entretient avec la Cour des comptes n’ont jamais été totalement satisfaisantes, même si elles se sont plutôt améliorées. Cet état de fait s’explique largement par des raisons historiques. La Cour des comptes s’interdit d’être un simple organe à la disposition du Parlement. Cette volonté d’affirmer une nécessaire indépendance n’a donc pas toujours facilité les relations avec les assemblées parlementaires. Des raisons plus techniques expliquent également les difficultés auxquelles se heurte la volonté de renforcer la coopération entre ces deux institutions. La Cour des comptes est, en effet, une juridiction chargée, notamment, de veiller à la régularité de l’exécution de nos finances publiques. Pour sa part, le Parlement, investi de la légitimité démocratique, demeure une instance politique, dont le jugement ne peut s’abstraire de tout point de vue politique.
Ces facteurs (historique et politique) expliquent que la collaboration entre ces deux institutions n’est pas «un acte naturel». Pourtant, les parlementaires doivent se convaincre que, dans un environnement budgétaire contraint, ils ont un rôle d’intérêt général essentiel à jouer, qui consiste à s’assurer de la meilleure affectation possible des fonds publics. C’est pourquoi ils doivent lier étroitement les décisions budgétaires qui leur sont soumises au résultat des contrôles et des études menées à leur initiative ou par la Cour des comptes. Le rapport annuel de celle-ci devrait donner lieu, préalablement, à l’examen du projet de loi de règlement, à des auditions par la Commission des finances, du premier président et des principaux magistrats qui ont participé à son établissement. Mesurer l’écart entre la Loi de finances initiale et le budget finalement exécuté peut nourrir non seulement les débats relatifs à la loi de règlement, mais surtout ceux concernant le projet de Loi de finances initial de l’année à venir. L’interaction entre la loi exécutée et celle en préparation est évidemment propre à enrichir la fonction de contrôle du Parlement et facilitera une analyse approfondie de la politique budgétaire suivie. Il est aussi souhaitable que le programme de travail établi chaque année par la Cour le soit désormais en coordination avec le Parlement, qui devrait alors formuler ses demandes en matière d’enquêtes et d’audits. Ces enquêtes pourraient, en particulier, utilement éclairer les parlementaires sur la sincérité des comptes de l’Etat.
Les relations entre les deux institutions auront à connaître des évolutions. La future nouvelle loi organique des finances va infléchir les orientations que la Cour donnerait à ses missions : ne plus limiter ses contrôles au montant de la dépense (ou de la recette) et au respect des règles juridiques qui les encadrent, mais à l’examen de leur efficacité au regard des objectifs qui ont justifié les autorisations budgétaires. De ce fait, la Cour doit opérer des modifications profondes dans ses relations avec le gouvernement et le Parlement, dans ses approches, ses méthodes, ses moyens et peut-être même son organisation. Elle doit ainsi modifier la présentation du rapport dans la perspective de la réforme de l’ordonnance actuelle ; elle doit procéder à une étude des rapports annuels de performance qui seront élaborés par les ministères afin d’alimenter la réflexion du Parlement. La nouvelle loi organique des finances va imposer aussi à la Cour un nouveau métier : la certification des comptes de l’Etat. L’exercice de la certification suppose que la Cour dispose des outils comptables nécessaires et des systèmes d’information adéquats. Chacun doit bien avoir conscience de l’ampleur de la tâche, et en particulier le Parlement, destinataire de la certification.
Mais le Parlement, comme le font ses homologues étrangers, doit aller au-delà de ces contrôles de régularité juridique et financière des dépenses : il doit s’intéresser à l’évaluation des politiques publiques qui sous-tendent les dépenses autorisées et contrôlées. Le Parlement est encore peu sensibilisé à cette démarche évaluative qui devrait échapper à toute approche partisane. Il appartient peut-être à ses représentants d’ouvrir la voie. Il faut pour cela une ferme volonté de transparence et de connaissance du réel, qui ne doit pas être confondue avec une accumulation d’informations. Là aussi l’assistance de la Cour des comptes peut être d’une grande utilité pour maîtriser la dépense publique et la redéployer afin qu’elle ait la plus grande efficacité économique possible. Traquer la dépense inutile et la mauvaise gestion ou démanteler l’empilement de structures ou de mesures injustifiées ne sont pas des démarches qui ont pour objet de mettre le gouvernement en difficulté. Au contraire, elles peuvent l’aider à résoudre des problèmes. Les deux institutions de contrôle et d’évaluation, chacune dans le respect de son rôle, ont donc un large champ à fertiliser en commun si elles ont la volonté de donner à l’intérêt général sa réelle signification.

