Idées
La confiance ne règne pas
Construire une prospérité pérenne est intimement lié à l’instauration d’une société où les rapports à l’Etat, les rapports entre individus sont bà¢tis sur la confiance mutuelle.
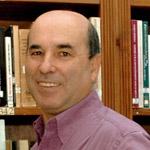
En 1970, Charles de Gaulle, après ses longues années au pouvoir, brossant le portrait de la France dans ses Mémoires d’espoir, constate que «… les rapports sociaux restent empreints de méfiance et d’aigreur. Chacun ressent ce qui lui manque plutôt que ce qu’il a». Une façon de souligner qu’en dépit des avancées économiques et sociales, les Français ont des rapports sociaux difficiles, marqués par la défiance. Un constat dressé avec brio par Yann Algan et Pierre Cahuc dans La Société de défiance qui a suscité un débat très riche sur les origines et les remèdes éventuels à apporter à ce qui apparaît, à tort, comme un mal typiquement français. Ce mal est aussi bien présent au Maroc, il imprègne les pores de notre société, comme en témoignent ces dénonciations au quotidien de l’injustice, de l’absence de confiance dans les rapports de l’Etat à la société, et les appels exprimés ici et là sur l’exigence de repères clairs, d’un respect des règles d’honnêteté et d’efficacité dans le fonctionnement des services publics.
Les Marocains se méfient de leur employeur, de leurs concitoyens (surtout s’ils sont riches) ou encore de la concurrence. Cette défiance va de pair avec un incivisme fréquent dans de nombreux domaines essentiels au bon fonctionnement de l’économie et de l’Etat social. Ne sont plus considérés comme une atteinte à l’éthique de conduite, les actes de resquiller pour accéder à un service à l’arrondissement du quartier, se soustraire au paiement des impôts ou demander indûment des aides publiques. Le comportement dominant est celui du contournement de la norme. Ces attitudes ne sont pas nouvelles. Une étude sur l’évolution des attitudes sociales sur une longue période révélerait probablement que le civisme et la confiance hérités de nos ancêtres se sont dégradés depuis bien longtemps. On pourrait penser qu’un atavisme pousse les Marocains d’aujourd’hui à se défier de tout, sans qu’aucun élément objectif ne justifie une telle attitude. Une telle interprétation serait erronée, car la confiance évolue au cours du temps. Aujourd’hui, les Marocains se méfient non seulement de leurs concitoyens mais également d’institutions aussi diverses que la justice, le Parlement, les syndicats, l’administration, le marché. Ils se méfient des institutions censées représenter leurs intérêts.
Le fait que des Marocains soient conduits à penser qu’il faille contourner les règles pour accéder à une prestation de droit révèle un véritable dysfonctionnement de nos institutions et de notre modèle social qui est supposé assurer la solidarité et la coopération entre les citoyens. Deux caractéristiques bien identifiées de notre modèle social entravent la confiance: le corporatisme et la bureaucratie. Le corporatisme se manifeste par l’octroi de droits sociaux associés au statut et à la profession de chacun. Ce qui segmente la société en institutionnalisant les différences entre citoyens et opacifie les relations sociales. Ce qui favorise la recherche de rentes entretient la suspicion mutuelle et mine les mécanismes de solidarité. La bureaucratie consiste à multiplier les procédures, distribuer les mêmes prérogatives entre plusieurs organismes ou instances. Ce dirigisme pervers finit par diluer la décision dans un maquis de réglementations, brouiller les responsabilités, induire une préférence pour les circuits personnalisés et générer des privilèges. Des attitudes qui défient les principes du droit et des devoirs, entravent la concurrence, vident le dialogue social de son contenu et favorisent la corruption. Ce type d’intervention, au détriment du respect des règles de la transparence et des mécanismes de solidarité, ne peut qu’entretenir la défiance mutuelle et favoriser, en retour, l’expansion du corporatisme et de la bureaucratie. Ce cercle vicieux mine l’efficacité et l’équité du fonctionnement de notre économie. Le manque de confiance des Marocains génère des coûts de développement. Non seulement la défiance entrave la croissance, mais aussi les capacités de réformes améliorant le fonctionnement de la démocratie sociale et politique. Plus fondamentalement, cette société de défiance s’accompagne d’un mal-être individuel, d’un malaise social marocain d’une moins grande aptitude au bonheur. Nous sommes, comme le pointait Alain Peyrefitte dans La société de confiance à propos des sociétés latines, dans une société frileuse, gagnant/perdant, une société où la vie commune est un jeu à somme négative ; une société propice à la confrontation sociale, au mal-vivre, à la jalousie sociale, à l’enfermement, à l’agressivité de la surveillance mutuelle. Pour redonner du sens aux rapports entre individus, Francis Fukuyama, dans un livre d’une subtilité rare, La confiance et la puissance, insiste sur les vertus sociales fondatrices de la prospérité économique. Sa thèse, qui mobilise autant Tocqueville que les entrepreneurs de Canton ou les syndicalistes de Turin, est implacable : réussite économique et solidité politique sont conditionnées par le fonctionnement harmonieux de la société. Pour l’avoir compris, Américains, Allemands et Japonais ont créé des sociétés à confiance forte. En revanche, Français, Italiens, mais aussi Chinois et Coréens en sont encore au temps de la suspicion et d’une économie qui semble fragile à l’heure de la globalisation des marchés. Le Maroc a les ressorts pour bâtir une société gagnant/gagnant, une société de solidarité, de projet commun et d’ouverture. La défiance ne constitue pas un trait culturel immuable ni une donnée intangible. Construire une prospérité pérenne est intimement lié à l’instauration d’une société où les rapports à l’Etat, les rapports entre individus sont bâtis sur la confiance mutuelle.
