Idées
La compétitivité des PME marocaines
les récentes réorientations des mesures et des fonds en faveur des PME et de la création d’entreprises innovantes n’ont pas encore donné tout leur potentiel en terme de dynamisme commercial de l’innovation
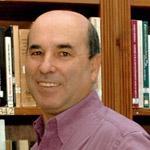
Les petites et moyennes entreprises marocaines font face, souvent avec difficulté, à la concurrence internationale. Elles innovent peu, elles n’exportent pas suffisamment, elles ne développent pas des stratégies conquérantes. C’est sans doute que l’environnement dans lequel elles évoluent n’est pas toujours favorable. Beaucoup de progrès restent à faire : les créations d’entreprises sont assez faibles et concernent encore peu les secteurs innovants technologiquement, alors même que le développement d’entreprises dans les domaines situés au cœur de la nouvelle économie constitue un enjeu important ; un retard préoccupant d’investissement matériel et immatériel s’est accumulé au cours des dix dernières années ; les PME restent encore insuffisamment tournées vers l’exportation. Le rôle des autorités publiques est, d’une part, de privilégier les deux piliers d’une économie de savoir que sont l’innovation et la formation, et, d’autre part, d’organiser une nouvelle régulation du secteur productif, moins fondé sur des interventions directes, mais donnant un cadre à l’action des entreprises, leur permettant d’atteindre les échelles aujourd’hui nécessaires pour affronter la concurrence internationale.
La compétition économique dépend de plus en plus des capacités d’innovation des entreprises. Or, si les performances académiques de la recherche sont souvent de bon niveau, les résultats technologiques sont décevants. Ainsi, la position du Maroc baisse dans le système méditerranéen de brevets. Les positions marocaines se dégradent dans l’électronique ou la pharmacie. Il y a peut-être là un problème de moyens, avec la faiblesse des crédits de la recherche. Il y a plus sûrement, d’abord, un défaut d’approches prospectives susceptibles de faciliter la construction de visions des priorités ; il y a aussi un problème de gouvernance, lié aux déficiences de la coordination entre les organismes et les équipes de recherche, à un manque de continuité des politiques et à une absence de culture de l’évaluation, enfin et malgré les progrès récemment réalisés, à une coupure encore excessive entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise. Parallèlement, les récentes réorientations des mesures et des fonds en faveur des PME et de la création d’entreprises innovantes n’ont pas encore donné tout leur potentiel en terme de dynamisme commercial de l’innovation.
En matière de formation, le Maroc a mis en œuvre, au cours des vingt dernières années, une politique volontariste qui s’est trouvée circonstanciellement amplifiée par les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes. La rapidité des changements et la perspective de l’allongement de la vie professionnelle conduisent à rechercher aujourd’hui un meilleur équilibre entre formation initiale et formation continue. Compte tenu du rôle que jouent dans les décisions d’embauche à la fois la conjoncture du moment et une appréciation large des compétences, allant bien au-delà des diplômes, l’écart s’est en effet accru entre les niveaux de formation initiale et les caractéristiques des postes sur lesquels les jeunes sont recrutés. Ce phénomène de «déqualification à l’embauche» conduit à s’interroger sur la pertinence d’un allongement exagéré de la formation initiale et sur la distinction traditionnelle entre formation initiale et formation continue. Ne conviendrait-il pas d’ouvrir, pour les jeunes, qui le souhaiteraient, un droit à la formation continue individuel et collectivement garanti, pouvant s’exercer tout au long de la vie professionnelle ?
L’action des entreprises s’exerce dans un cadre concurrentiel qui organise le contrôle de la concentration et des positions dominantes, l’interdiction des ententes, la surveillance du caractère discriminant des subventions aux entreprises, l’ouverture des marchés publics. Dans le but d’augmenter l’efficacité de l’action des PME, il est nécessaire de mettre sur pied des dispositifs puissants de régulation, s’appuyant sur l’organisation d’une autorité indépendante, afin de veiller à un accès équitable aux marchés, aux ressources financières et aux infrastructures. L’intensification de la concurrence dans les activités appelle sans doute la promotion de nouvelles régulations touchant les droits de propriété intellectuelle, la protection des libertés individuelles, le commerce électronique. Dans plusieurs domaines s’opère une évolution profonde donnant à côté des mesures réglementaires plus de poids aux incitations économiques. Il est vrai que dans un environnement économique complexe et mouvant, il est beaucoup plus efficace de laisser les acteurs économiques déterminer eux-mêmes leurs modalités d’adaptation aux objectifs collectifs, en n’introduisant des contraintes que lorsque c’est justifié. Dès lors que les incitations, notamment fiscales, sont correctement calibrées, il devient possible aux PME d’atteindre des objectifs de performance, dans les meilleures conditions.
