Idées
La CGEM, tour de Babel
Le patronat marocain présente-t-il vraiment un front uni dans la défense de ses intérêts ? Pas vraiment ! Difficile en effet de concilier les points de vue de tous les adhérents compte tenu de l’incroyable diversité du tissu
formé par les entreprises.
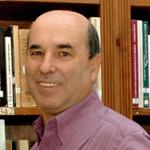
La bataille pour la succession de Moulay Hafid Alami à la tête de l’organisation patronale est ouverte depuis quelques mois. Rien ne transparaît sur d’éventuels désaccords dans les rangs patronaux sur les dossiers de politique économique et sociale. Tout semble se focaliser sur les querelles de clans et de personnes. Ce contexte est récurrent. La CGEM est une organisation qui a toujours été travaillée par des contradictions internes, mais qui les a toujours résolues, au moins en façade. C’est un choix historique, confirmé à plusieurs reprises.
Le patronat marocain présente-t-il vraiment un front uni dans la défense de ses intérêts ? Pas vraiment ! Difficile en effet de concilier les points de vue de tous les adhérents compte tenu de l’incroyable diversité du tissu formé par les entreprises. A priori, tout est simple : la CGEM représente l’ensemble des entreprises et son président est, dit-on souvent, le «patron des patrons». Mais si l’on y regarde à deux fois, cette image banale fait l’effet d’un décor de théâtre, avec façades en trompe-l’oeil. C’est sûr, il n’y a rien d’évident à mener sous une même bannière la TPE de Témara-Plage et le PDG d’un grand groupe ou à concilier les intérêts de la grande distribution et ceux des patrons de PME. Diversité sociale des chefs d’entreprise, divergences d’intérêts entre secteurs économiques, poids des fédérations professionnelles, légitimité contestée des échelons interprofessionnels patronaux au plein sens du terme, on a bien tort de ne parler du patronat qu’au singulier. Aujourd’hui comme hier, la profession est le niveau prépondérant d’organisation des chefs d’entreprise. Chaque groupement défend des intérêts catégoriels, mais contribue aussi à la construction sociale d’une profession. Les entreprises n’ont qu’un sentiment d’appartenance diffus à une confédération, et la fonction d’arbitrage n’est pas toujours facile, surtout en phase de ralentissement ou de crise économique.
Pour nombre de patrons, la CGEM n’est pas beaucoup plus qu’un instrument, parmi d’autres, pour leurs propres actions de lobbying : hors de ses instances, les dirigeants des plus grands groupes initient des actions d’influence discrète aux plus hauts niveaux de l’Etat grâce aux réseaux qu’ils entretiennent… La confédération défend les patrons-propriétaires, qu’elle identifie au «patronat réel», par opposition au «patronat de gestion». La distinction peut faire mouche : l’autodidacte trimant à la tête d’une entreprise familiale ne se reconnaît pas tellement dans le miroir policé que lui tend une CGEM où pullulent les cadres salariés des grands groupes et un bon nombre de responsables patronaux issus de la haute fonction publique. Dans les dossiers les plus techniques, ce sont les grands groupes qui peuvent déléguer des spécialistes dans les commissions. Les représentants de PME, même s’ils constituent le gros des adhérents, n’en ont ni le temps ni les moyens. Il faut cependant bien faire droit à la «sensibilité PME». La CGEM a bien créé récemment une commission PME, mais sans pour autant cesser d’apparaître comme la maison des grandes entreprises. Même si son président prend garde à se montrer attentif aux états d’âme du petit patron.
La CGEM n’est pas, non plus, en mesure d’imposer une quelconque discipline à ses fédérations, comme l’attestent les fortes réticences de certaines branches à mettre en musique les orientations de la direction. Bien des prises de position patronales continueront donc à voguer au gré des rapports de force internes. Mais les fédérations, elles-mêmes, ne sont guère mieux loties. Elles agissent sous le contrôle étroit des chefs d’entreprise qui font prévaloir leurs intérêts à court terme. Certains dirigeants tentent de renouveler le mode d’action et la réflexion patronale, ce dont témoigne le regain d’activité de mouvements de pensée. Mais cela n’embraye pas auprès du gros des troupes. Sauf pour la galerie, comme en témoigne la reprise du thème de l’entreprise citoyenne ou le label qualité, lancé il y a quelques années. Une organisation représentative du patronat ne peut pas en même temps clamer que les entreprises ont une responsabilité dans la cité et se déboutonner dès qu’il s’agit de prendre des engagements concrets ou de passer des compromis avec les syndicats. Sauf à perdre sa crédibilité et à renvoyer la balle à l’Etat, qui doit souvent suppléer aux carences de la négociation collective. Au-delà de cet enjeu, une mise à plat des structures bancales du patronat supposerait que l’utilité d’un niveau central soit reconnue et légitimée. Il ne s’agit pas de couper la tête aux grands pour agrandir les petits. Mais des redistributions du pouvoir oui. L’annonce des élections ou du renouvellement de la direction lèvera-t-elle ce suspense ? Elles se dérouleront sans grand enjeu, mais il est à souhaiter que les changements ne soient pas que de simples retouches.
