Idées
La bourse des valeurs littéraires
Dans le beau texte que paul valéry a consacré à verlaine dans « variété », il rappelle dans sa conclusion cette vérité que, chez nous, certains prétendus poètes et autres journalistes nés du hasard et de la nécessité ignorent : « on oublie très aisément que, par nécessité de son état, le poète doit être le dernier des hommes à se payer de mots ».
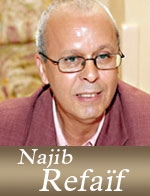
En 1926, sous les auspices de la Société des Nations (SDN), ancêtre de l’actuelle ONU, il fut créé en France un Institut international de la coopération intellectuelle. Plusieurs hommes de lettres et hommes de sciences, dont Albert Einstein ou Paul Valéry, avaient pris part aux travaux d’une commission dont les travaux ont été publiés dans un numéro de la revue L’Europe nouvelle. Paul Valéry, qui faisait partie de la sous-commission «Lettres et Arts», avait travaillé sur un rapport consacré à la traduction. C’est dans ce rapport qu’il eut cette idée lumineuse, mais qui serait passée aujourd’hui, sinon pour une lubie de poète, du moins pour une utopie : la création d’une bourse des valeurs littéraires.
Dans un texte inédit (qui vient d’être publié en même temps que d’autres documents tout aussi inconnus de Valéry sous la direction de son meilleur biographe Michel Jarrety Souvenirs et réflexions, Editions Bartillat), l’auteur de la Jeune Parque écrivait : «Toute coopération intellectuelle entre nations de langues différentes exige essentiellement que les ouvrages capitaux de ces diverses nations puissent, dans une certaine mesure, être connus de l’une par l’autre. (…) J’ai pensé à l’institution d’une commission spéciale internationale, siégeant une fois par an, qui aurait pour mission d’exprimer, les ayant recueillis, les désirs des nations, et de débattre, enfin, la composition d’une liste d’ouvrages recommandés aux traducteurs. Ce serait, en somme, une véritable “Bourse des valeurs littéraires transmissibles”. (Car il en est d’intransmissibles, les poètes le savent !)». Paul Valéry continuera, dans le cadre du PEN Club français, dont il était le président de 1926 à 1936, à militer pour la création de cette «Bourse des valeurs littéraires». La suite de l’histoire est connue. Plus de SDN, plus de Bourse. Les conséquences de la Grande Guerre ont obligé les nations à se réunir dans une autre organisation internationale qui a toujours eu et qui a encore aujourd’hui d’autres chats à fouetter. «Une bourse des valeurs littéraires transmissibles», proclamait Valéry qui ajouta, «car il en est d’intransmissibles, les poètes le savent !». Ce que savent les poètes aujourd’hui, et pas seulement eux, c’est que ce qui se transmet en bourse et les valeurs qui y prévalent sont loin, très loin de la poésie. Les chiffres ont remplacé les lettres depuis belle lurette, parce que, comme le criait le personnage campé par Michael Douglas dans Wall Street, le film d’Oliver Stone, «Greed is good !» (La cupidité, c’est bien.) Mais un autre poète et non des moindres, Hölderlin, disait bien avant : «Mais ce qui reste, les poètes le fondent».
D’un poète, l’autre, c’est l’auteur des Fleurs du Mal qui se présente sous un autre visage et dans un autre registre, celui de journaliste-chroniqueur et critique d’art. Si cette dernière activité est plus ou moins connue chez les baudelairiens plus ou moins avertis, l’exercice journalistique ne l’est pas toujours. Baudelaire journaliste, Articles et chroniques (Garnier/Flammarion) est un livre qui réunit un florilège d’écrits qui sont loin de l’image du poète maudit popularisée par la «vulgate scolaire et les manuels», comme l’explique dans une excellente introduction l’auteur de cette sélection d’articles et de chroniques, Alain Vaillant, qui précise : «D’abord et avant tout, Baudelaire est le parfait exemple (banal du point de vue de son parcours, mais exceptionnel par son génie) de l’écrivain-journaliste du milieu du XIXe siècle : plus exactement de ces professionnels de la petite presse culturelle qui, entre poésie,critique littéraire ou artistique, fiction et chronique, sont les polygraphes de la modernité». En effet, cette anthologie, qui navigue entre la littérature et le journalisme, donne à lire et apprécier à la fois l’étendue de la palette de l’auteur des Fleurs du Mal, sa force de conviction politique, le ton libre et bien entendu le style à la fois pur et parfois désinvolte d’un auteur aux multiples facettes. De plus, nombre de thématiques esquissées ici sont d’une grande modernité de par leur aspect novateur et souvent inattendu de la part d’un poète de cette époque. Preuve s’il en est que les poètes sont toujours en avance sur leur temps et parfois aussi sur celui à venir. Par ailleurs, on relève aussi la propension à l’humour ravageur et à l’ironie grinçante, voire à la facétie et la moquerie. Gauthier fait les frais de cette dernière pendant que Balzac, admiré par Baudelaire, a le beau rôle dans un article plein d’humour intitulé «Comment on paie ses dettes quand on a du génie ?».
Et c’est ainsi que dans cette bourse des poètes, même la moindre églogue pleine de petites fleurs et d’abeilles a valeur de vertu littéraire et patrimoniale. Tous les poètes ont laissé des traces et non des preuves car, comme le disait René Char : «Seules les traces font rêver». Mais ces traces sont faites de mots et si le poète ne se paie pas de mots, il est crédité d’une belle postérité dans la véritable «Bourse des valeurs littéraires transmissibles». Dans le beau texte que Valéry a consacré à Verlaine dans Variété, il rappelle dans sa conclusion cette vérité que, chez nous, certains prétendus poètes et autres journalistes nés du hasard et de la nécessité ignorent : «On oublie très aisément que, par nécessité de son état, le poète doit être le dernier des hommes à se payer de mots».
