Idées
Haro sur la destruction de l’emploi
Devant l’engagement des pouvoirs publics à vouloir faire de la lutte contre le chômage une priorité nationale il est fondamental d’élaborer des indicateurs d’évaluation et de suivi des flux de création /destruction d’emploi
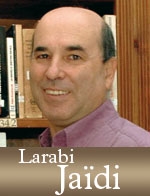
Les travaux sur le marché du travail mettent souvent en exergue les créations d’emplois réels ou potentiels. Ils nous renseignent sur le dénombrement des effectifs et des besoins, nous livrent un résultat net mais ne rendent pas suffisamment compte de l’ampleur des flux bruts d’emploi (créations + destructions), au regard des flux nets (créations – destructions). Or, même lorsque l’emploi global et le chômage sont stables, le marché du travail est le lieu de mouvements de main-d’œuvre et de créations/destructions d’emplois de grande ampleur. La réalité de la destruction des emplois montre aussi que le phénomène des mutations n’est pas réservé à quelques secteurs industriels considérés en crise mais qu’il affecte en permanence l’activité économique. Les emplois supprimés sont aussi localisés dans l’espace : ainsi, ce sont des bassins d’emplois et, plus largement, des territoires géographiques, qui se trouvent affectés. Du point de vue de l’emploi, on peut se demander si la priorité de la politique économique ne doit pas s’efforcer autant de limiter les destructions que de favoriser les créations. Retenir ces deux objectifs invite à améliorer la circulation de la main-d’œuvre entre emplois détruits et emplois créés.
Pourquoi s’intéresser à la destruction de l’emploi ? Une première raison est qu’il s’agit d’une réalité socio-économique au moins aussi pertinente que l’est celle de la création de postes. Une destruction d’emplois est un évènement vécu négativement par les intéressés et les décideurs publics, qu’elle soit compensée ou non par des créations d’emplois dans d’autres entreprises ou dans d’autres secteurs. Une seconde raison est que la connaissance de ces flux de destruction peut conduire à modifier les priorités des politiques économiques. Il est effectivement important de savoir si le taux de chômage observé est la résultante de mouvements d’entrées-sorties élevés ou faibles : selon le cas, on assistera à un chômage fréquent mais de courte durée ou à un chômage moins fréquent mais de longue durée et les deux types de chômage n’appellent pas le même traitement. Raisonner en termes de destruction permet aussi de mieux caractériser les effets de l’ouverture de l’économie. Celle-ci alimente les deux côtés du processus de création/destruction. La croissance des flux d’importations est un facteur de destruction d’emplois lorsque cette croissance va au-delà de celle de la demande intérieure. A l’inverse, l’investissement direct étranger et la croissance des exportations sont des facteurs de création d’emplois. Tous ces mouvements ont aussi des effets négatifs ou positifs en termes d’emplois induits. C’est l’ensemble de ces mouvements qu’il faut s’efforcer de comprendre.
D’une manière générale, dans l’évolution du marché du travail on constate un effet miroir à plusieurs niveaux. Les territoires sont positionnés sur des activités soumises à de fortes mutations structurelles, qu’elles soient liées à l’émergence de nouveaux secteurs (automobile, aéronautique) ou à la déperdition d’activités traditionnelles (textile, agroalimentaire, mines, BTP…). Les régions les plus riches (PIB / habitant) sont celles qui créent le plus d’emplois mais également celles qui en suppriment le plus grand nombre. Le même effet de miroir s’applique à la taille des entreprises : les PME – TPE sont les structures qui créent et en même temps suppriment proportionnellement le plus d’emplois. Le constat est d’autant plus vrai que leur très grande majorité est positionnée sur des secteurs ou créneaux fragiles (services de survie, petite agriculture) et peu d’entre elles sont sur les filières porteuses ou innovantes (éco-activité, e-commerce, recyclage, etc.).
Comptabiliser et analyser les flux de destruction de l’emploi a, donc, un intérêt en soi. Il est nécessaire de mieux apprécier les différentes dimensions de la dynamique des flux de destruction d’emplois, telles que la nature des emplois détruits, la pérennité des nouveaux emplois créés, l’importance des créations d’emplois occasionnels par rapport à l’emploi permanent, la comparaison des gains et des pertes d’emplois des entreprises exportatrices par rapport à celles travaillant pour le marché local, la différence des mécanismes agissant sur la destruction de l’emploi dans les secteurs formel et informel. Une autre dimension du problème consiste à examiner les grands groupes de facteurs qui contribuent aux créations/ destructions d’emplois à un niveau méso-économique (la demande, la productivité, les changements technologiques, la concurrence internationale) et à un niveau micro-économique, à l’échelle de l’entreprise.
Si, dans notre économie, les créations d’emplois sont relativement bien observées, les destructions d’emplois sont, par contre, peu caractérisées et analysées. Devant l’engagement des pouvoirs publics à vouloir faire de la lutte contre le chômage une priorité nationale il est fondamental d’élaborer des indicateurs d’évaluation et de suivi des flux de création /destruction d’emploi. C’est ainsi que l’on pourra identifier des mesures de soutien permettant de réduire les risques de fermetures et d’échecs d’entreprises qui engendrent la suppression d’emplois et proposer des dispositifs efficients pour l’accompagnement des entreprises.
