Idées
Fébrilité sur la multidimensionnalité de la pauvreté
Même si la plupart des pays adoptent un concept de pauvreté monétaire, il ne faut pas pour autant négliger des définitions basées sur d’autres formes de privations que la consommation, le manque de capacités ou les difficultés d’accès à des services sociaux de base.
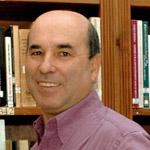
L’approche statistique de la pauvreté pose des problèmes conceptuels et de mesure, qui se trouvent démultipliés dans le cas des comparaisons internationales dès lors que l’on cherche à mettre en perspective des sociétés très diverses, tant sous l’angle des niveaux de vie actuels que de leur histoire économique et politique. Les définitions nationales sont loin d’être unifiées. Même si la plupart des pays adoptent un concept de pauvreté monétaire, il ne faut pas pour autant négliger des définitions basées sur d’autres formes de privations que la consommation, le manque de capacités ou les difficultés d’accès à des services sociaux de base. L’usage conjoint de plusieurs approches est la meilleure façon de décrire sans trop le réduire le phénomène complexe qu’est la pauvreté.
Parce que la première difficulté à laquelle se heurte l’étude de la pauvreté est, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’absence de véritable définition : ni les sociologues ni les économistes ne fournissent de définition précise permettant la quantification. Que tout concept ait besoin d’être défini n’est qu’une évidence; que cette définition puisse ne pas être «naturelle» n’a en fait rien d’exceptionnel non plus. C’est le cas de nombreuses grandeurs, en sciences sociales, qui pourraient apparaître au premier regard comme naturelles que d’être en fait des constructions sociales qui supposent toute une série de conventions plus ou moins explicites. Il en va ainsi du chômage, des classes sociales, du temps de travail, de la plupart des nomenclatures, de l’illettrisme, etc. Mais tout est affaire de degré, et avec la pauvreté on est dans un cas extrême. On se convainc aisément que la notion de classe sociale est tributaire d’un schéma théorique hypothétique; dans le domaine de l’emploi, les notions conventionnelles ont en général fait l’objet de discussions entre partenaires sociaux pour en négocier les limites. Ici, les mesures utilisées n’ont pas encore abouti et, plus important encore, c’est dans la définition elle-même que s’introduit explicitement un jugement de valeur et d’éthique sur la pauvreté. Autre point important, l’écart entre les réflexions des sociologues, voire des économistes et les mesures adoptées par les statisticiens atteint dans ce domaine des proportions exceptionnelles. Cette absence de définition précise est un bon révélateur des nombreux problèmes sous-jacents, tant au plan conceptuel qu’au niveau de la mesure, qui frappent toute approche du phénomène. Elle incite aussi à développer des approches multidimensionnelles de la pauvreté.
Les travaux récents ont montré qu’au moins les trois types de pauvreté, monétaire, en conditions de vie et subjective, étaient distincts: l’absence d’une forte corrélation entre les formes de pauvreté est confirmée. La faiblesse de ces corrélations interpelle. Sans doute est-elle en partie due à l’existence d’erreurs de mesure ; néanmoins le traitement de ces erreurs ne permet pas de se ramener, même de loin, à un indicateur unidimensionnel. On a bien affaire à des populations différentes. Certes, quand on regarde qui sont les divers types de pauvres, il y a des ressemblances, des facteurs communs (faiblesses en compétences, difficultés d’insertion, problèmes de santé, etc.), mais aussi de fortes différences (selon l’âge, le type d’habitat, etc.). Les personnes âgées par exemple ont davantage tendance à être pauvres monétairement, mais pas dans les autres dimensions: elles n’ont pas de grands moyens, mais elles ne veulent (ou ne peuvent) s’endetter, et se contentent de ce qu’elles ont, elles ne désirent pas les biens qu’elles n’ont jamais eus et auxquels elles n’ont jamais eu l’occasion de s’accoutumer. De fait, toutes ces définitions permettent d’isoler des sous-populations qui présentent des fragilités, mais elles ne convergent pas vers un ensemble bien identifié que l’on pourrait considérer comme les pauvres.
L’avenir est donc bien à l’approfondissement des approches multidimensionnelles de la pauvreté. Nul doute que le travail statistique inédit qui a été fourni par l’Institut d’Oxford ne fasse faire un pas important à la connaissance de l’inégalité et de la pauvreté. Des sèches réprobations politiques ont été exprimées par la diplomatie marocaine à la publication de ces travaux de recherche qui présentent un classement du Maroc jugé «inacceptable». Si le dossier peut apparaître sensible, il est quand même très en retrait par rapport à l’agenda de la diplomatie marocaine et ses exigences. Une attitude qui dénote d’une certaine fébrilité du classement international du Maroc dans ce domaine et dans bien d’autres. Aucune statistique nouvelle n’est à l’abri des critiques. Mais laissons le soin aux organismes appropriés de se saisir de ces travaux, d’apprécier leur apport et leur déficience. Ils sont plus qualifiés pour ces tâches. Les réserves émises sur la méthodologie mise en œuvre ne doivent évidemment pas conduire à rejeter en bloc ces travaux sous prétexte qu’ils seraient imparfaits. Il ne faut pas non plus les négliger. Elles dessinent en effet le cadre dans lequel économistes, sociologues et statisticiens, sans parler des forces politiques, devront travailler pour que progresse notre appréhension de la pauvreté et de l’inégalité. Et le chemin est dans ce domaine particulièrement semé d’embûches, tant sont grandes les difficultés conceptuelles, méthodologiques et opérationnelles soulevées par le recours à l’utilisation d’indicateurs synthétiques. La possibilité d’agréger, dans un score doté de bonnes qualités statistiques, les éléments divers, pour ne pas dire disparates, qui constituent l’approche de la pauvreté multidimensionnelle n’est pas aisée. Vouloir faire rentrer de force un phénomène multidimensionnel dans un moule unique ne saurait se faire sans déformer ou caricaturer la réalité au risque de mal orienter les éventuelles politiques correctrices. D’ailleurs, l’appareil statistique national a parcouru du chemin dans sa volonté de dépasser le cadre étriqué de l’approche de la pauvreté par les seules ressources monétaires, tout en gardant la lisibilité garantie par la mise en avant d’un chiffre unique. Mais l’indicateur produit est imparfait. Sur ce point, sans conteste, la demande politique est ambivalente, désireuse à la fois de simplicité et de précision et de valorisation de l’impact des politiques publiques. S’il est clair que la voie à suivre éloigne de la prise en compte du seul niveau des ressources monétaires, l’exemple de l’Indicateur de la Pauvreté Multidimensionnelle illustre bien, de par ses imperfections, la difficulté du chemin qui reste à faire pour aboutir à une approche qui rencontre une large approbation.
