Idées
Emergence II : le triangle des 3F
La gestion institutionnelle des engagements est un des moteurs essentiels de
la performance globale
des entreprises et de la nation. Cette gestion n’est pas toujours assurée au Maroc de façon satisfaisante.
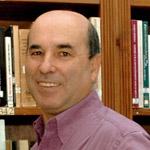
Dans l’histoire de l’économie marocaine, la politique industrielle a fait l’objet de tentatives récurrentes, mais aucune n’a véritablement décollé, sans doute à cause de conceptions trop éloignées des exigences de l’environnement et d’une absence de vision partagée par les acteurs. Aujourd’hui, force est de constater que le Maroc a initié une politique volontariste de renouvellement du tissu industriel. C’est ce constat que le plan Emergence fait ressortir. Il y a néanmoins quelque paradoxe à vouloir évoquer Emergence II quand les objectifs d’Emergence I ne se sont pas encore concrétisés. Il n’y a pas de rupture dans les choix. La redéfinition de la carte industrielle mondiale dans les secteurs de l’automobile, l’aérospatial et l’électronique offre des opportunités majeures pour capter des niches. Il y a tout de même quelques ajustements: un programme agressif de promotion du textile, un plan de restructuration des filières des denrées de base nationales, des mesures transversales plus ramassées. En somme, la première mouture d’Emergence était très ambitieuse dans ses annonces et très «sexy» dans son allure. La nouvelle gagne en sobriété. Un chiffrage mieux cerné, des mécanismes de gouvernance plus précis. Le cap est toujours le même, mais les objectifs sont revus à la baisse. A l’horizon 2015, un gain additionnel de 50 milliards de dirhams du PIB au lieu des 100 milliards affichés dans la version 2005. Une création de 220000 emplois au lieu des 500000 annoncés dans la première version. Un volume supplémentaire d’exportations de 95 milliards de dirhams au lieu d’une réduction aléatoire de 50% du déficit des échanges. Plus de réalisme ? Tant mieux. Les effets d’annonce immodérés n’ont jamais été un signe de crédibilité. Le chiffrage rectifié est en lui-même déjà très ambitieux. Quand on compare les performances dessinées aux tendances de ces deux dernières décennies, c’est un véritable saut qui est attendu dans la croissance, l’emploi et les exportations. Les moyens mobilisés sont-ils à la mesure de l’ambition ? Les mesures prévues sont encastrées dans le «triangle des 3 F»: le foncier, la formation et le financement. Un triangle profondément déséquilibré. La politique foncière prend une place prépondérante et quasi déterminante avec l’identification de plateformes intégrées généralistes ou dédiées. La politique de formation est sensible aux arguments des industriels à la recherche de profils adéquats en quantité et en qualité. Quant à la politique de financement, elle a diversifié ses produits, ses aides, ses incitations mais pèche par manque de rigueur. Globalement, le budget du programme est évalué à 12,4 milliards de dirhams. Un flou persiste sur ses sources de financement. L’Etat s’engage à allouer 5,5 milliards d’ici 2008. Le reste ? D’où viendra-t-il ? Selon quel échéancier sera-t-il dépensé?
Par ailleurs, si le programme a mis l’accent sur les réformes liées au climat des affaires, il n’a pas moins occulté des thèmes d’intervention qui conditionnent, de nos jours, la réussite d’une politique industrielle. Tout d’abord, la coopération interentreprises. Aujourd’hui, elle est au cœur des réseaux qui constituent la substance même de tout système productif. C’est par la promotion de ce type de coopération que l’on parvient à densifier réellement le tissu industriel. A accroître sa flexibilité en l’incitant à externaliser une partie des activités et se concentrer sur le métier d’origine. Emergence n’a rien prévu comme mesures permettant d’actionner le levier du partenariat entre les différents acteurs d’une filière, d’amont en aval. Ensuite, l’innovation : c’est aussi un défi principal auquel est confronté l’entreprise industrielle marocaine. Elle est synonyme d’encouragement de la «matière grise», de l’investissement immatériel. Elle suppose l’appui aux programmes embryonnaires de recherche. Là aussi, les relations contractuelles entre les universités et les entreprises, les transferts de connaissance du laboratoire vers les entreprises avaient besoin d’un appui. Pour permettre au tissu industriel de s’orienter vers une compétitivité différenciée, assise sur une maîtrise des avantages hors coûts. Enfin, la construction d’un système productif repose aussi sur les dynamiques territoriales concertées. On assiste avec P2I à une ré-émergence des économies industrielles régionales. Toutefois, l’impulsion des dynamiques territoriales spécifiques ne se réduit pas à un simple effet lié à l’existence d’une plateforme foncière de standard international. Elle est conditionnée par l’existence d’un potentiel de relations contractuelles, d’engagement des collectivités territoriales, de politiques locales de développement, de capacités de pilotage stratégique. La gestion institutionnelle des engagements est un des moteurs essentiels de la performance globale des entreprises et de la nation. Cette gestion n’est pas toujours assurée au Maroc de façon satisfaisante. La raison d’une moindre efficacité de l’intelligence institutionnelle tient moins à des facteurs «techniques» qu’à des attitudes culturelles. Si, dans d’autres pays, la gouvernance de la politique industrielle est performante, c’est parce qu’elle s’appuie sur un profond sentiment collectif de patriotisme économique. C’est ce sentiment qu’il convient de susciter de nouveau au Maroc, pour que l’Emergence soit au rendez-vous.
