Idées
De quoi ce présent est-il le nom ?
A l’heure où l’on évoque timidement, ici et là , le centenaire du protectorat et alors que nous avons dépassé le cinquantenaire de l’indépendance, il ne serait pas inutile d’inscrire sommairement notre histoire contemporaine dans celle du xxe siècle, ne serait-ce que pour la commodité du raisonnement ou de la lecture. ainsi aurions-nous un récit coupé quasiment en deux parties égales : de 1906 (traité d’algesiras, puisque tout est parti de là ) à 1956 date de l’indépendance et de cette période à … quand déjà ?
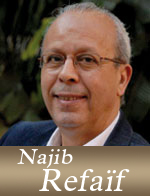
Si «l’histoire a besoin de temps pour accoucher», comme le soutient le grand historien Paul Veyne, de combien de temps le présent a-t-il besoin pour produire de l’histoire ? Dans une présentation à son ouvrage, «Comment on écrit l’histoire» (Point Seuil), Paul Veyne précise en réponse à la sempiternelle question : Qu’est-ce que l’histoire ? : «…Les historiens racontent des événements vrais qui ont l’homme pour acteur ; l’histoire est un roman vrai».
On pourrait bien entreprendre, lorsqu’on est citoyen de ce beau et vieux pays qui est le nôtre, le récit d’une histoire racontée comme un roman. Pourquoi pas ? D’autant que les archives, les documents et tous les matériaux nécessaires dont devrait disposer l’historien sont difficilement accessibles, parfois indéchiffrables et souvent introuvables. Et l’on ne parle ici que de l’histoire dite contemporaine.
D’ailleurs, à ce sujet, on peut se demander à partir de quand peut-on parler au Maroc d’une histoire contemporaine ? La question n’est pas vaine si l’on considère que la contemporanéité a un début comme marqueur, à savoir une période introductive déterminée, mais sa limite est celle d’un présent qui court encore. Bref, l’histoire, pour qu’elle accouche, a besoin de temps. C’est donc ce «temps» qui la définit et la légitime. A l’heure où l’on évoque timidement, ici et là, le centenaire du Protectorat et alors que nous avons dépassé le cinquantenaire de l’indépendance, il ne serait pas inutile d’inscrire sommairement notre histoire contemporaine dans celle du XXe siècle, ne serait-ce que pour la commodité du raisonnement ou de la lecture. Ainsi aurions-nous un récit coupé quasiment en deux parties égales : de 1906 (traité d’Algesiras, puisque tout est parti de là) à 1956 date de l’indépendance et de cette période à… quand déjà ?
On se souvient d’un document qui avait fait grand bruit en son temps, mais dont on ne parle plus aujourd’hui. Il s’agit du rapport du Cinquantenaire élaboré collectivement par un grand nombre de chercheurs et d’experts toutes disciplines confondues.
Ce rapport avait fait un diagnostic intraitable et franc dans lequel on a relevé un certain nombre de dysfonctionnements, mis au jour les failles, notamment du système éducatif, ses échecs successifs et ses réformes intempestives ; on y a aussi pointé d’autres anomalies et incuries en matière de gouvernance dans plusieurs domaines socio-économiques et culturels.
Plus proche de l’aveu d’échec que de l’inventaire d’autosatisfaction dont on a abusé par le passé, ce rapport est un outil de travail intéressant pour qui veut raconter le récit historique du pays comme un roman vrai. On peut deviner la contrariété sinon le courroux de certains de nos historiens patentés, confortablement installés dans leur vision servilement chronologique, coulant de source et onctueusement hagiographique. Mais nous sommes au moins deux générations démographiques (si l’on considère que deux fois vingt cinq ans sont égales à un cinquantenaire), à avoir été sinon les acteurs, du moins les spectateurs de ce récit historique raconté comme ce roman vrai dont parle Paul Veyne.
En effet, comme on l’avait signalé en son temps et au moment de la publication et de la promotion du fameux Rapport du Cinquantenaire, on peut se considérer comme le rat de laboratoire sur lequel on a effectué toutes sortes de recherches inabouties, de réformes biscornues, de bricolage et autre bidouillage politiques. Nombre de nos contemporains portent encore sur eux les marques de ces recherches vaines comme des échardes plantées à fleur de mémoire. Voilà pourquoi il est des jours où tout est brouillé dans leur tête lorsqu’un présent politique échevelé rappelle un passé décomposé. On écrit le passé, c’est-à-dire l’histoire, des hommes qui ont écrit. Qu’a-t-on écrit qui puisse laisser des traces et non des preuves, car «seules les traces font rêver», disait le poète René Char ? C’est alors que des hommes sans passé, ces «immémorants» errant sans but se posent cette question pleine de désarroi : de quoi ce présent est-il le nom ?
Concluons avec Paul Veyne ce que nous avons commencé avec lui. Evoquant l’histoire comme récit des événements, l’historien et professeur au Collège de France écrit dans le chapitre intitulé «L’objet de l’histoire» : «Comme le roman, l’histoire trie, simplifie, organise, fait tenir un siècle en une page et cette synthèse du récit est non moins spontanée que celle de notre mémoire quand nous évoquons les dix dernières années».
