Idées
Dans les allées du pouvoir
nous devons nous réjouir de la diversité de certaines sources de richesse et de la présence de nombreux milliardaires venus de nulle part : leur présence, au contraire, est le signe que quelque chose de positif se passe dans le pays et on doit se réjouir aussi de leur contribution au développement.
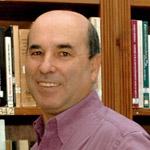
Nous le savons, la société marocaine n’est pas vraiment méritocratique. On n’y occupe pas toujours un poste conforme à ses diplômes et à ses compétences. Si la relative démocratisation de l’enseignement était censée offrir à tous des chances égales, ce sont bien «les riches» qui exercent aujourd’hui l’essentiel du pouvoir économique et politique. Ou plus exactement les héritiers, car les riches ne constituent pas une catégorie statistiquement définie ; les héritiers, c’est-à-dire ceux qui sont issus des milieux les plus favorisés, financièrement, culturellement et socialement. Le pouvoir économique, technocratique et politique demeure aux mains d’une élite restreinte. Richesse et pouvoir sont intimement liés et leur relation complexe est subtile. La richesse est en effet plurielle, multiforme : c’est l’argent, les relations… Le pouvoir, lui, peut s’exercer dans différents champs : l’économie, la politique, la science, etc. La richesse donne du pouvoir, un rapport de force favorable : l’argent permet d’acheter tout ce qui peut l’être, la culture et les relations permettent d’accéder à des postes élevés. Mais le pouvoir procure aussi de la richesse, qu’il s’agisse d’argent, de privilèges ou de reconnaissance. Le couple se forme inéluctablement, l’un et l’autre se nourrissent mutuellement.
Les rares études sur la structure du capital des entreprises marocaines et sur l’origine de leurs dirigeants attestent la présence toujours forte des grandes familles. Elles contrôlent le capital des plus grandes comme des moyennes entreprises marocaines. Quant aux dirigeants des plus grands groupes, beaucoup d’entre eux occupent ce poste par relation privilégiée – d’identité ou de parenté – au détenteur du capital et certains d’entre eux sont des héritiers : ils n’ont eu qu’«à bien naître ou à bien se marier». Le nombre croissant de managers salariés ne contredit pas cette analyse. Certes, il n’est plus nécessaire de posséder tout ou partie du capital d’une entreprise pour la diriger. Il faut des compétences. Mais le mode de recrutement des patrons des entreprises assure la permanence de l’entre-soi. Une grande partie des patrons des entreprises marocaines, publiques ou privées, sont issus de la haute fonction publique ou des grandes écoles (Polytechnique, Ponts et chaussées, Mines). Le jeu des relations sociales, la proximité des centres de décision, les amitiés politiques et le maintien de soi font ensuite le reste tout au long d’une carrière. Comment la connivence entre technocrates et dirigeants du monde économique n’irait-elle pas de soi, alors qu’ils sont interchangeables et formés selon le même moule ?
Il ne faut point être choqué par ce profil de «riches», comme s’ils avaient volé leur patrimoine et s’étaient enrichis en exploitant les autres. Nous devons plutôt nous réjouir de la diversité de certaines sources de richesse et de la présence de nombreux milliardaires venus de nulle part: leur présence est le signe que quelque chose de positif se passe dans le pays et on doit se réjouir aussi de leur contribution au développement. Certes, les Bill Gates ne courent pas nos rues mais nous avons de véritables entrepreneurs, qui sont de vrais créateurs, inventant ce qui n’existait pas et surtout rendant un service aux clients. Et ils ont contribué à créer de la richesse pour tous, des emplois en grand nombre. Si le Maroc comptait un peu plus de milliardaires de ce type, les syndicats et les bonnes âmes se scandaliseraient, mais l’économie en bénéficierait. Mais ce profil est rarissime. Il a surtout son opposé. Quelques fortunes qui se sont constituées sont assez suspectes ; les milliardaires du trafic de drogue et de la contrebande par exemple, voire de la spéculation foncière, n’ont pas très bonne réputation. Mais ces fortunes scandaleuses ont plus de chance de se produire lorsque l’Etat est tolérant ou ferme les yeux. Il y a aussi ces nouveaux riches, les personnes qui se sont enrichies rapidement, parfois de manière suspecte, et qui dépensent leur argent de manière ostentatoire. C’est aussi sans surprise que l’on constate que le processus électif ne remet pas en cause la confiscation du pouvoir par les classes dominantes. La plupart des députés sont issus du décile de la population le plus favorisé, économiquement et culturellement. Quant au phénomène de l’hérédité en politique, que l’on croyait d’un autre siècle, il a en fait tendance à s’accentuer depuis une quinzaine d’années. A cela s’ajoutent les immuables familles de notables locaux. A l’évidence, les électeurs ne sont ni stupides ni masochistes, mais l’argent, les réseaux, l’aisance, la prestance, le beau langage… permettent d’accéder plus facilement à la représentation politique, de passer sur les médias et de convaincre du bien-fondé de ses opinions, voire dans certains cas de corrompre pour conserver le pouvoir. Au-delà des clivages politiques et d’une certaine diversité socioculturelle des classes les plus favorisées, le pouvoir économique, technocratique et politique demeure aux mains d’une élite restreinte.
