Idées
Construire les vraies places du Maroc
Le débat sur la pertinence des indicateurs des institutions internationales est ouvert. Il n’est pas question d’être
-a priori- favorable ou hostile à tel indicateur
ou tel autre.
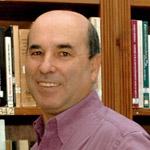
Les classements du Maroc annoncés chaque année par diverses institutions internationales ne cessent de surprendre par leurs contradictions et leur caractère parfois paradoxal. Ces institutions sont nombreuses. Pour n’en citer que quelques-unes, avec les classements qu’elles produisent : Banque Mondiale (Doing businnes, Gouvernance), Climat des Affaires (US Aid), World Economic Forum (ou Forum économique mondial, Global Competitiveness Index,), ONU (Human Development Index,), Heritage Foundation (Economic Freedom Index), … Bien entendu, les diverses institutions mesurent des notions différentes et plus ou moins larges : attractivité, compétitivité, degré de libéralisme économique, qualité des institutions et de nombreuses autres. Le classement international établi par ces institutions révèle souvent la piètre performance de l’économie nationale qui ne se situerait qu’à des rangs peu enviables, dépassée par nombre de ses voisins. Dans la mesure où ces résultats étonnants voire inquiétants donnent lieu à de nombreux commentaires, il convient d’en discuter la pertinence. Les comparaisons internationales de niveaux des performances économiques, comme celle du développement humain, nécessitent un traitement adéquat des différences des données dans l’espace. Les multiples choix de méthodes et de sources statistiques qui sont faits alors jouent largement sur les résultats. La méthodologie des indices élémentaires est essentielle pour le suivi/évaluation des performances économiques ou sociales. Celle des indicateurs composites, qui est devenue d’un usage répandu, ne l’est pas moins. L’une et l’autre soulèvent en même temps de nombreux problèmes. Ces différents travaux, aussi nécessaires soient-ils, souffrent effectivement, à des degrés divers, de faiblesses méthodologiques qui limitent quelque peu leur utilité concrète. Tout d’abord, la qualité des sources : dans certains cas, la qualité des sources de base utilisées peut être contestée. C’est tout particulièrement le cas des données issues d’enquêtes d’opinion. Par exemple, la méthodologie de Doing Business conduit à interroger chaque groupe d’hommes d’affaires nationaux sur leur opinion concernant leur pays d’origine. Les jugements portés sur les différents pays ne proviennent donc pas du même échantillon de personnes. Ceci peut induire des biais, d’ailleurs difficiles à mesurer, fonction notamment de la propension plus ou moins forte d’un groupe national à émettre publiquement des critiques sur son propre pays. Ensuite, le choix des indicateurs : le choix des indicateurs de base lui-même peut révéler des a priori idéologiques. Il risque également d’induire des biais non contrôlés dans le travail de comparaison. Par exemple, l’existence d’une pression fiscale élevée dans un pays n’est pas en soi un facteur de non-compétitivité. Le pays en question peut en effet très bien avoir choisi de financer un certain nombre de services de base par l’impôt plutôt que par des mécanismes de marché. Tout dépend alors évidemment de l’utilisation, plus ou moins efficace, qui est faite de l’argent public pour financer ces services.
L’analyse des différents indicateurs montre à quel point des choix idéologiques sous-jacents ou parfois simplement une absence de réflexion méthodologique sérieuse viennent brouiller l’analyse objective de la situation. Par exemple, les index ONU de «développement humain» insistent implicitement surtout sur l’impact de la dépense, en multipliant les indicateurs liés à la santé, à l’éducation, etc., tandis que les conditions de contexte ou de financement sont largement négligées. Quant à l’Heritage Foundation, le biais idéologique y devient caricatural, car c’est l’existence même d’une dépense publique élevée (y compris en santé ou éducation), qui y est considérée comme néfaste. Enfin : le mode de calcul de l’indicateur de synthèse. Ceci conduit à poser le problème des pondérations retenues pour chaque indice de base et de la formule de calcul utilisée pour établir l’index synthétique. Dans son domaine de prédilection, chaque institution choisit les indicateurs élémentaires et les pondérations qu’elle juge pertinents et produit généralement un classement synthétique destiné à communiquer efficacement son message. Les indicateurs élémentaires reflètent certaines réalités tout en occultant de nombreuses autres, ou reflètent les opinions de secteurs choisis de l’économie et de la société – orientées par les formulations retenues et avec le risque calculé de confondre opinions et réalités. Des travaux récemment menés par l’OCDE montrent que des classements globaux très différents peuvent être obtenus à partir des mêmes données de base, non seulement en fonction des pondérations accordées à chaque composante (ce qui est évident), mais également -ce qui est plus grave- en fonction du mode de calcul retenu aussi bien pour la mesure des indicateurs élémentaires eux-mêmes (classement, écart à la moyenne, regroupements par niveaux, sélection des seules données extrêmes..) que pour leur combinaison (moyenne arithmétique, géométrique, etc.).
Le débat sur la pertinence des indicateurs des institutions internationales est ouvert. Il n’est pas question d’être -a priori- favorable ou hostile à tel indicateur ou tel autre. Il faudrait discuter le pouvoir explicatif propre à chaque indice, admettre la difficulté à obtenir une pondération correcte des critères, de croiser les regards sur ces instruments en commençant par l’organisation d’un débat national transparent sur ces questions pour construire les «vraies» places du Maroc.
