Idées
Consommation : les inégalités persistent
Dire que les «pauvres» ont moins accès que les riches aux biens de consommation est très relatif, il faut compter avec les habitudes culturelles et l’existence de la contrefaçon. En revanche, les inégalités s’expriment de manière plus distincte quand il s’agit d’acquérir des services.
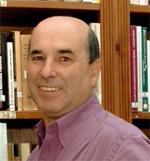
A quoi les Marocains consacrent-ils leurs dépenses ? Appareils ménagers, Internet, lecteurs CD : les standards de la consommation moderne progressent, mais les clivages sociaux sont toujours aussi marqués. L’alimentation vient toujours en tête, mais en très légère baisse. Elle représente aujourd’hui 40,1% de leur budget, contre 41% en 2001.
Le logement devrait suivre une logique inverse, mais, paradoxalement, il se situe dans la même tendance à la baisse relative : il ne pèse plus que 20,2% des ressources des ménages, contre 22,1% en 2001. L’habillement et l’équipement de la maison sont également orientés à la baisse : la part accordée aux biens d’équipement du foyer (meubles, réfrigérateurs, téléviseurs…) est passée de 3,9% à 3,6%. En revanche, les dépenses de santé, de transport et de communication occupent une part croissante.
Cette évolution est-elle conforme aux observations du statisticien allemand Ernst Engel ? Au milieu du XIXe siècle, il avait constaté que plus le revenu augmentait, plus la part du budget consacrée à la satisfaction des besoins vitaux diminuait, en particulier l’alimentation.
La résistance à la baisse de la part des produits alimentaires dans les dépenses des ménages marocains apporte une nuance à cette tendance. L’évolution des coefficients budgétaires – la part des dépenses consacrée à chaque poste – s’explique aussi par l’évolution des prix, qui peut être différente selon les produits.
Un poste peut diminuer, non parce que l’on consomme moins les biens qu’il englobe, mais parce que leurs prix progressent moins que dans d’autres secteurs. On l’a vu de façon spectaculaire ces dernières années pour les produits bruns (hi-fi, vidéo) et la micro-informatique. Inversement, la croissance des dépenses de logement ne s’explique pas seulement par l’amélioration de la qualité : extension des surfaces habitées, plus confort. Elle tient aussi aux effets de la hausse des prix du loyer et de l’énergie.
L’augmentation du niveau de vie moyen, malgré la crise de l’emploi, a permis à une grande majorité de Marocains d’accéder à la «société de consommation», à travers la diffusion des biens d’équipement du foyer. C’est à partir de ce constat que l’on a tendance à conclure à une «moyennisation» de la société marocaine. Mais, contrairement aux apparences, cette diffusion est lente.
Tous pareils ? A vrai dire, l’homogénéisation croissante des normes de consommation s’accompagne, du fait de la diversité des produits offerts et de la possibilité pour chacun d’affirmer sa différence, de pratiques de consommation plus libres et plus individualisées.
Le brouillage des frontières entre les univers sociaux a remis en scène d’autres clivages : lieu et type d’habitation, sexe, âge, etc. Mais les très fortes inégalités de revenus dans notre société ne se sont pas accompagnées d’une réelle homogénéisation des modes de consommation et de vie. Les ménages modestes consacrent une part importante de leur revenu à l’alimentaire, au logement et au transport, au détriment de l’équipement de leur foyer, des loisirs ou des vacances. Le loyer ou les traites du logement, les factures d’eau et d’électricité sont logiquement des dépenses prioritaires.
Reste que les inégalités ne se limitent pas à l’opposition extrême entre la masse des consommateurs et les exclus. Les disparités de revenus nourrissent des disparités importantes dans les modes de consommation. Dans les biens d’équipement ou l’habillement, la consommation de produits de marques fait souvent la différence entre catégories sociales. Comme cela a toujours été le cas, les innovations technologiques bénéficient d’abord aux ménages privilégiés, avant de connaître une diffusion plus large.
Il en est ainsi de l’Internet ou de la téléphonie mobile, même si ces deux exemples indiquent également que la démocratisation s’effectue aujourd’hui plus rapidement que par le passé. Les inégalités de consommation ne sont pas toutes liées à des disparités de revenus.
Les livres ne sont pas spécialement coûteux, mais ils sont nettement plus présents chez les ménages des couches sociales supérieures. Les modes de consommation sont tributaires d’un capital culturel. Ils reflètent aussi des codes de comportement qui différencient les individus : porter des vrais vêtements Nike pour aller faire son footing ou bien des imitations pour aller travailler n’a pas la même signification.
Au-delà de la généralisation de la possession de certains objets, liée à la chute du prix relatif des produits manufacturés, les inégalités s’expriment de plus en plus nettement à travers la consommation des services, qu’ils soient collectifs ou marchands.
Les voyages lointains, l’hôtel, les restaurants, les spectacles restent un signe distinctif des ménages favorisés, tout comme le recours à des services à domicile. Dans la mesure où les services consistent pour l’essentiel à acheter le temps des autres, on comprend que leur essor s’effectue sur une base inégalitaire.
