Idées
Conseil économique et social : une crédibilité à reconquérir
Quels que soient les arbitrages à rendre entre les intérêts en présence, certains principes et règles de composition du Conseil économique et social peuvent être mis en Å“uvre afin de mieux asseoir la représentativité de ses membres : celui de l’ajustement périodique de la composition, celui de la limitation du nombre de mandats dans le temps. Autrement, on favoriserait l’émergence de «professionnels de la représentation».
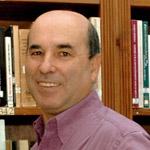
Le Maroc est un pays qui, tout en affirmant à l’envi l’importance de la concertation pour le développement de l’économie et la qualité des relations sociales, ne confère pas à la pratique de cette concertation une place importante. Cette situation tient à des raisons historiques qui ont façonné le modèle des relations sociales propre à notre pays. Une évolution de ce modèle n’en était pas moins nécessaire. Le CES répondra-t-il à cette exigence ? L’utilité de cette institution n’est plus à démontrer. Les relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux connaissent régulièrement des périodes de tension et d’incompréhension réciproque. Le CES peut, il est vrai, sous certaines conditions, favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux et la société civile et diffuser une nouvelle culture du dialogue dans la sphère publique. Mais encore faudrait-il, pour ce faire, que sa formation émane d’une représentation peu contestable.
Composition : une difficulté plus politique que technique
Le plus difficile des problèmes posés par la création d’un Conseil économique est toujours celui de sa composition. Difficulté technique, sans doute. Difficulté politique, surtout. Au nombre des critiques émises figurent déjà notamment la sous-représentation de la société civile, la déconnexion entre la représentation des organisations syndicales et leur audience réelle dans le monde du travail et la nécessaire représentation particulière de «grandes causes» portées par des associations, comme la pauvreté, le développement local, l’immigration, les consommateurs et usagers, ainsi que la représentation spécifique des jeunes, de femmes et des personnes âgées. En fait, la société civile inclut un ensemble extrêmement varié d’associations de défense des grandes causes ou de proximité. Elle est largement polymorphe. Des intérêts souvent contradictoires, voire conflictuels, sont représentés, ce qui appelle en son sein la recherche de convergences pour mieux définir sa représentation dans la nouvelle institution. Il serait toutefois illusoire d’exiger du Conseil économique et social qu’il soit parfaitement représentatif de la société. Une assemblée d’une centaine de membres ne peut prétendre traduire l’extrême diversité d’une société en rapide mutation et la répartition des sièges entre les catégories requiert une part de subjectivité qui n’est pas, par définition, partagée par tous. A supposer même qu’un critère satisfaisant conduise à établir une pondération idéale de la représentation des intérêts, celle-ci ne peut épouser la variété des sujets dont est saisi le conseil. Pour autant, la composition de cette assemblée doit s’efforcer de refléter de manière suffisamment fidèle l’organisation et la structuration de la société.
Quelle procédure de nomination des personnalités
Toute composition du conseil sera nécessairement le fruit de compromis entre des pressions catégorielles. C’est la procédure de nomination des personnalités qui doit être entourée d’un cadre et de critères rigoureux pour éviter certaines dérives. La présence des personnalités qualifiées ne peut être affaiblie par des nominations surprenantes ou offertes en guise de lot de consolation. Que de CES dans certains pays ont constitué un moyen commode de recaser d’anciens ministres, de consoler des candidats malheureux aux élections, de récompenser des militants, d’émousser la pugnacité de certains opposants… Les pouvoirs publics ont sans doute davantage à gagner d’un conseil indépendant et donnant une image aussi fidèle que possible de la société civile, plutôt que d’un énième organisme consultatif à leur disposition et sous leur contrôle. Quels que soient les arbitrages à rendre entre les intérêts en présence, certains principes et règles de composition peuvent être mis en œuvre afin de mieux asseoir la représentativité : celui de l’ajustement périodique de sa composition, celui de la limitation du nombre de mandats dans le temps. Autrement, on favoriserait l’émergence de «professionnels de la représentation», dont le lien avec la catégorie représentée peut se distendre avec le temps.
Une audition annuelle du Premier ministre ?
Par ailleurs, l’autorité et la crédibilité du CES dépendront très largement de son mode de fonctionnement et de l’origine des demandes dont il sera saisi. Si les autosaisines doivent être admises pour marquer l’indépendance de l’institution, il n’est pas sain que l’essentiel de l’activité de l’institution repose sur ce mode d’activité. C’est pourquoi ce mode doit être réservé aux thèmes de réflexion d’une importance particulière. Le conseil doit être obligatoirement consulté sur certains dossiers, ce qui contribuera à asseoir son autorité. A cet égard, la concertation à laquelle elles donnent lieu avec le gouvernement, devrait constituer davantage un gage d’efficacité qu’un facteur de brouillage. La saisine parlementaire offre également l’occasion d’un resserrement des liens entre les deux institutions. Pourquoi ne pas ouvrir le droit de pétition aux citoyens, une voix susceptible de bouleverser certaines habitudes de travail ? En sus d’un rapport écrit annuel, une audition annuelle du Premier ministre pourrait être prévue en assemblée plénière, lors de laquelle ce dernier rendrait compte, de manière circonstanciée, des conséquences que le gouvernement a ou va tirer des travaux du Conseil.
Au-delà, c’est sans doute davantage au CES lui-même d’assurer le suivi de ses propres avis, de développer ses relais pour diffuser ses analyses. Le CES n’est pas une instance de plus dans la myriade d’organismes de concertation …. C’est plus d’une dizaine de conseils supérieurs, conseils nationaux, voire hautes autorités qui peuplent aujourd’hui le paysage institutionnel, de manière parfois très opportune, souvent moins. Ce foisonnement institutionnel ne serait pas en soi problématique s’il ne contribuait à donner le sentiment que le pays peut se payer le luxe du superfétatoire et, plus encore, s’il ne renforçait, par la confusion des messages que ces institutions sont censées diffuser.
C’est donc par sa performance que le CES pourrait être porteur de valeurs fortes de participation et de responsabilité en s’appuyant sur des pratiques de concertation et de délibération solidement ancrée et offrant un cadre adéquat pour une modernisation institutionnelle.
