Idées
Comment Al Khawarizmi a inventé Google
On n’a pas toujours été nuls et on pourrait même dire que l’on a contribué, avant Larry Page et son compère Sergey Brin, à l’élaboration de Google. Si Mohammed Ibn Mussa Al Khawarizmi n’avait pas la tête dans les nuages et avait déposé son invention, on aurait engrangé comme des malades des royalties à ne plus savoir qu’en faire.
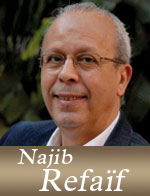
Voilà une technique, encore une, dans le monde de l’informatique que l’on a affublée -une fois n’est pas coutume- d’une appellation presque poétique : «L’informatique dans les nuages», en anglais «cloud computing». Attention ! être dans les nuages ne veut pas dire dans les rêveries solitaires, ou complètement détaché des contingences ou de la réalité. Chez ces gens-là, monsieur, on ne rêve pas monsieur, on compte puis on stocke. Il s’agit précisément de stockage des données que l’on confie à des sociétés spécialisées qui vous soulagent du trop-plein d’informations. Entreprises et individus qui ne veulent ou ne peuvent pas disposer de serveurs peuvent leur confier cette tâche de calcul et de stockage à la demande. En clair, on «externalise» ou on sous-traite sa mémoire pour ne pas se lancer dans un investissement capitalistique pour l’entreprise et lourd pour un utilisateur «geek» ou un professionnel compulsif. Les avertis, qui s’y connaissent, nous disent que cette technique n’est pas nouvelle, ni révolutionnaire puisque le fait d’utiliser son Hotmail, son Gmail ou tout autre webmail c’est confier sa mémoire aux nuages et donc faire dans du cloud computing. Sauf que c’est gratos parce que la faible capacité de stockage le permet. Le Maroc n’est pas en reste en matière de «cloud computing». Le quotidien l’Economiste (18 octobre 2011) rapporte qu’un colloque organisé le mois dernier à Casablanca a permis de réunir des experts et des responsables d’entreprises pour discuter des perspectives d’avenir de cette technique et en faire la promotion auprès notamment des PME. Le thème était on ne peut plus promotionnel : «Le cloud computing, source d’agilité, d’efficacité économique et d’opportunité de business». Tout cela, soulignent les organisateurs, entre dans le cadre de la stratégie nationale connue sous une appellation qui évoque un nom de code secret : «Maroc numeric 2013». Mais comme toujours, il y a les sceptiques qui mettent en avant le vide juridique marocain en la matière, pendant que d’autres invoquent la loi qui interdit l’expatriation des données à l’étranger, considérées comme un patrimoine national. Bref, c’est pas gagné. On se permet, au passage, de rappeler à l’agence organisatrice de cet événement et portant le joli nom d’«Epitaphe», que ce vocable d’origine gréco-latine signifie inscription funéraire ou un écriteau sur une tombe, si vous préférez ? Et si on creuse encore un peu le sens, il est donné en archéologie, justement, à la tablette qui porte une inscription funéraire. D’accord, il s’agit de planquer des informations dans les nuages, là-haut dans les cieux infinis, mais c’est quand même mal barré pour donner vie à une technique qui a du mal à s’implanter sur nos terres.
Cette petite incursion dans le monde virtuel pourrait faire croire, à tort, que l’auteur de ces lignes est un mordu de la chose informatique, alors que pas du tout ou pas tant que ça ; ce n’est que l’expression d’une simple curiosité de la part d’un utilisateur qui consomme Internet avec modération et circonspection. En fait, c’est bien l’appellation de la fonction qui séduit bien plus que la technique elle-même. Admirez l’envolée lyrique : «Une mémoire dans les nuages». C’est un beau titre pour poètes débutants ; ou mieux encore, pour le titre d’un roman sur la fatalité du destin : «C’est écrit dans les nuages !». C’est presque le titre d’un mauvais film d’amour à oublier comme «J’écrirai ton nom sur le sable !» (Sa aktoubo ismaki faw9a arrimal).
Il est vrai que le monde informatique et donc numérique est essentiellement fait de lettres et ne vit que par elles. Ce n’est donc pas, contrairement aux apparences, un domaine de chiffres mais de lettres. Certes, à l’origine il est né d’un système de numération décimale en mathématique appelé algorithme, mot arabe latinisé qui vient d’Al Khawarizmi, un génie arabo-musulman né en Ouzbékistan mais qui a grandi et étudié dans le Bagdad des Lumières du IXe siècle. Comme quoi on n’a pas toujours été nuls et on pourrait même dire que l’on a contribué, avant Larry Page et son compère Sergey Brin, à l’élaboration de Google. Si Mohammed Ibn Mussa Al Khawarizmi n’avait pas la tête dans les nuages et avait déposé son invention, on aurait engrangé comme des malades des royalties à ne plus savoir qu’en faire. Signalons tout de même qu’au moment où l’on écrivait cette chronique et en tapant les noms Larry, Sergey et même Google, l’ordinateur les a tous soulignés en rouge. Inconnus au bataillon. Pour Google, le dictionnaire de l’ordinateur a proposé «Goodyear», allez savoir pourquoi ! Il faut dire aussi que les gens de Microsoft, jaloux et revanchards, ne peuvent pas encadrer ceux de Google et pour cause ! En revanche, si revanche il y a, le patronyme en entier d’Al Khawarizmi a été validé. Il y a une justice numérique et «c’est ainsi qu’Allah est grand !» comme l’excellent Alexandre Vialatte aimait à conclure ses belles chroniques de La Montagne. Enfin, toujours à propos de Google et de l’importance des mots dans l’informatique, on peut lire avec profit un article intéressant (Le Monde diplomatique, novembre 2011) soutenant une astucieuse théorie sur ce que l’auteur de cet article, Frédéric Kaplan, chercheur à l’école Polytechnique de Lausanne, appelle «le capitalisme linguistique». Dès l’incipit, l’auteur annonce la couleur et l’angle d’attaque : «Le succès de Google tient en deux algorithmes : l’un, qui permet de trouver des pages répondant à certains mots, l’a rendu populaire ; l’autre, qui affecte à ces mots une valeur marchande, l’a rendu riche».
