Idées
Cette crise qui a modifié en profondeur le comportement des investisseurs
L’OCDE prévoit une année 2011 prometteuse pour les investissements transfrontaliers. Le Maroc se situait avant la crise dans une fourchette de 0,3 à 0,4% d’investissements OCDE drainés. Se situer durablement autour de 0,5% de l’investissement mondial serait une belle performance.
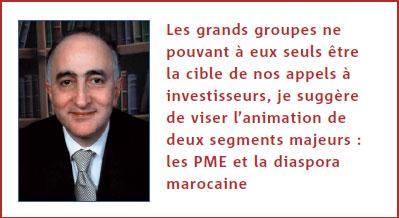
L’OCDE vient de publier les derniers indicateurs des investissements étrangers. Le constat est préoccupant : les fusions et acquisitions internationales devraient diminuer de 56% en 2009 par rapport à 2008, baisse la plus marquée d’une année sur l’autre depuis 1995. Les opérations provenant de l’OCDE atteignaient 1000 milliards de dollars en 2008 et sont tombées à 454 milliards en 2009.
Deux crises en réalité se sont succédé : une crise financière qui a asséché pendant un temps la liquidité et une crise économique qui a raréfié les fonds propres des banques et des grands investisseurs. Il s’en suit une aversion au risque sans commune mesure avec la vision d’avant la crise.
L’aversion au risque augmente de façon prohibitive la prime de risque incluse dans les rendements probabilistes des portefeuilles. L’exemple récent de la Grèce est significatif. L’Etat grecque se refinance aujourd’hui à plus de 260 points de base que l’Allemagne ou la France. Cela montre à quel point le risque pays effraie un marché devenu frileux.
Les investisseurs deviennent très sélectifs, parfois outrageusement vis-à-vis de pays considérés risqués et à faible enjeu contributif au résultat.
Ce comportement nouveau efface souvent d’un coup, d’un seul, les nombreux atouts dont peut se prévaloir légitimement le pays hôte.
A regarder de près, le classement risque-pays de l’OCDE place le Maroc au 3e rang sur une échelle de 0 à 7. Très honorable classement sachant que tous les pays développés sont au classement 0. Presque aucun pays n’est à 1 et les classés 2 sont le plus haut de la fourchette des pays émergeants riches.
C’est un formidable encouragement à continuer à travailler sur nos forces et commencer à atténuer le poids de nos faiblesses. Ces dernières sont connues depuis si longtemps et déjà maintes fois adressées par les observateurs et par les différents gouvernements: environnement fiscal, droit du travail, lutte contre la corruption, exemplarité de la justice, procédures administratives de contrôle…qu’il n’est nul besoin d’y revenir.
Je ne nie pas l’importance de tous ces facteurs, mais l’expérience montre qu’ils ne deviennent importants que lorsque d’autres critères, que l’investisseur regarde en priorité, sont absents.
Un exemple pourrait illustrer mes propos. A l’occasion d’une étude d’implantation d’un grand groupe en Chine et en Inde, quelle ne fût ma surprise de voir des procédures tatillonnes et même ultra contrôlées ; une corruption importante dans au moins l’un de ces deux pays ; une fiscalité souvent plus lourde pour les étrangers que pour les locaux ; des prises de contrôle capitalistiques impossibles et une présence étrangère plus tolérée que souhaitée par la population locale. Et pourtant, malgré tout cela, je ne crois pas qu’il existe un seul grand groupe européen qui ne soit pas installé ou qui n’étudie pas en permanence la possibilité de s’installer dans ces deux pays. Aucun mystère évidemment, la taille du marché fait rêver, parfois à tort, tout investisseur étranger. Mais au-delà, toutes les conditions habituellement demandées aux pays hôtes deviennent secondaires lorsque les critères de risque et de rentabilité des investissements sont dominants. Comment alors mieux appréhender ces critères appliqués à notre pays, dans des approches plus pragmatiques qu’académiques ?
Pour une approche plus focalisée et moins exclusive des grands groupes
Les groupes cotés en Bourse raisonnent essentiellement par rapport à l’impact de leur communication et décisions sur le cours de Bourse. Les analystes examinent basiquement les investissements : améliorent-ils la capacité bénéficiaire du groupe ; quel est le risque d’échec ; quel est l’impact de ce risque ; le groupe est-il capable de gérer cet investissement ? C’est ainsi que la pondération risque/rendement se fait et c’est ainsi que le groupe est crédité ou non de bien investir.
Avec la crise, le manque de fonds propres pousse les groupes à moins saupoudrer et à plus se centrer sur les investissements les moins risqués, en relation avec la stratégie adoptée. C’est ainsi que, géographiquement, beaucoup de pays émergents sont sortis des «radars» car ils ne représentent pas suffisamment de contribution au résultat, de par leur marché intérieur et c’est également ainsi que les pays à risque fort, même en Europe, sont en train de sortir des «radars» malgré un marché prometteur et une rentabilité beaucoup plus importante que celle des investissements dans les pays développés. Sans oublier une remontée importante des résultats qui pèse sur le solde des paiements.
Loin de moi l’idée de minimiser l’apport des grands groupes à l’investissement au Maroc. Mais dans une période chahutée avec une forte aversion au risque, les méthodes qu’utilisent ces mêmes groupes vis-à-vis de leurs actionnaires peuvent s’avérer utiles pour garder la proximité, l’anticipation et donc la capacité de manœuvre à chaque fois que cela est utile.
Ne nous méprenons pas. L’action menée par le gouvernement est non seulement nécessaire mais démontre une vraie volonté politique. Plusieurs ministres ne ménagent pas leurs efforts pour réussir des road-shows de qualité en direction d’investisseurs occidentaux.
Un des compléments majeurs de la réussite est le suivi individualisé et régulier des principaux investisseurs. Une ou deux fois par an, une présentation bilatérale des réalisations, un tableau de bord précis et adapté au business du groupe et un chiffrage, de part et d’autre des actions de la période à venir, pourraient contribuer à un dialogue utile pour agir et comprendre l’évolution des souhaits pour les partager.
Un contexte difficile mondialement et encourageant localement
Le Maroc, malgré évidemment une forte baisse des investissements étrangers, réalise une performance intéressante dans le paysage mondial en 2009. Les 9 premiers mois de 2009 voient l’investissement étranger baisser de 36% environ par rapport à la même période de 2008. Comparés aux -56% d’investissements étrangers dans le monde, nous gagnons significativement des parts de marché. Mais cela démontre que la concurrence entre pays hôtes deviendra de plus en plus féroce pour partager un gâteau d’investissements qui devient, lui, plus réduit.
2010 va être une année de reprise molle dans les grands pays investisseurs. Mais l’OCDE prévoit une année 2011 prometteuse pour les investissements transfrontaliers. Le Maroc se situait avant la crise dans une fourchette de 0,3 à 0,4% d’investissements OCDE drainés. Se situer durablement autour de 0,5% de l’investissement mondial serait une belle performance.
Une action plus segmentée est la clé d’une construction solide dans le temps
Les grands groupes ne pouvant à eux seuls être la cible de nos appels à investisseurs, je suggère de viser l’animation de deux segments majeurs : les PME et la diaspora marocaine.
L’Europe est un continent de PME. L’Italie, l’Espagne et même la France en sont une bonne illustration. Une partie significative de l’innovation est aujourd’hui concentrée dans des PME. Il convient de les repérer, de les approcher et de leur offrir les facilités qu’elles recherchent. Les banquiers étrangers présents au Maroc pourraient servir de recruteurs conseil pour leurs clients PME. Chacun y trouvera son intérêt. Il faut garder à l’esprit que l’offshoring d’activités existantes est, et sera, de plus en plus difficile à réaliser pour des raisons sociales. En revanche, les activités nouvelles et la mise en œuvre d’innovations constitue un terreau plus acceptable par le corps social en Europe en cas de création d’activité à l’étranger. L’offshoring n’est pas mort mais il est sacrément souffrant et son antidote est l’innovation et la création d’activités nouvelles.
Un autre segment est encore plus perméable : celui de nos compatriotes qui sont devenus des moteurs de l’économie en Europe. Certains par leur propre entreprise, d’autres via des entreprises qui les emploient représentent une vraie opportunité pour le Maroc. Cette population est très insuffisamment animée, souvent pas du tout. Elle est pourtant très attentive au développement du Maroc. Différents cercles peuvent servir de base à approcher ceux qui voudraient s’investir dans des programmes de développement. On serait surpris de la force et de l’énergie d’un tel potentiel et surtout de sa qualité d’écoute. Bâtissons avec eux un plan d’ampleur qui les implique dans la construction du Maroc de leurs enfants.
Enfin notre action se doit d’être plus opportuniste. Le monde est aujourd’hui mobilisé autour des enjeux de qualité de l’environnement. Nous ne sommes qu’au début d’un processus, ces moments où les places ne sont pas toutes prises. Nous serions bien inspirés d’adopter cette voie, car plus nous nous affirmerons comme volontaires pour participer à la révolution environnementale, plus les investissements nous suivront. Il ne s’agit pas là de faire, comme souvent, une vitrine qui ne correspond pas au fond du magasin. Il s’agit de rechercher et de mettre en place un programme ambitieux qui favorise l’investissement respectueux de l’environnement. Malgré Copenhague, ne soyons ni naïfs ni conservateurs. Nous pourrions viser haut car notre image en sera bénéficiaire, mais nous devons également laisser à notre industrie le temps d’adaptation car les périodes de transformation sont parfois longues.
Faire des centrales solaires est un pas important, favoriser la production solaire décentralisée et atomisée peut être un excellent complément. La production et l’installation de panneaux solaires est, pour une large part, l’affaire de PME. Avec celles-ci, il est plus facile de trouver de bons deals et de créer des pôles d’expertise au Maroc.
Passer des accords en vue de production de voitures électriques, quitte à engager une partie des dépenses de l’administration dans l’achat et l’utilisation de telles voitures comme monnaie d’échange.
Encourageons également les entrepreneurs marocains à s’allier à des entreprises de BTP en vue d’importer les techniques de construction HQE minimisant le bilan carbone.
Il faut profiter du dispositif dont le Maroc vient de fixer le cadre via le plan national d’efficacité énergétique ou la loi sur les énergies renouvelables, pour attirer l’innovation, la production et pas seulement la consommation de ces technologies. Il m’apparaît que plus nous serions en pointe sur l’innovation, plus nous pourrons dégager des marges de manœuvre pour laisser du temps d’adaptation aux entreprises marocaines qui constituent le fondement de notre économie.
Le temps des études théoriques est derrière nous, il nous appartient d’emprunter les voies, plus pentues mais plus prometteuses, des réalisations.
* Ancien membre du COMEX de Crédit Agricole SA, chargé du développement international.
