Idées
Auteurs sans Å“uvre
Salon, intérieur jour. Cette disposition de mise en page introduit généralement un scénario et fixe une séquence ; elle sera suivie d’une description du décor s’il n’est pas déjà connu.
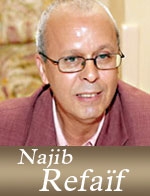
Salon, intérieur jour. Cette disposition de mise en page introduit généralement un scénario et fixe une séquence ; elle sera suivie d’une description du décor s’il n’est pas déjà connu. Viennent enfin des personnages, connus ou pas, qui vont se mettre à parler ou pas. Cela paraît tout simple et c’est ce qu’on appelle une mise en page d’écriture qui va individualiser la séquence. Cela ressemble à l’écriture d’une pièce de théâtre et lorsque c’est bien fourni en détails, et surtout bien écrit, on dirait même un texte de littérature. Voilà pourquoi, lorsqu’il s’agit du scénariste, on parle d’auteur de scénario mais pas de film. La paternité de ce dernier est généralement imputée au réalisateur. C’est pour cela aussi que l’on dit qu’un scénariste est un écrivain sans œuvre. Celle-ci va se transformer au fur et à mesure de la production du film pour ne faire du texte écrit qu’un simple manuscrit raturé, plié, froissé par tous les intervenants dans la production : réalisateur, acteurs de premier ou de second plan, techniciens etc. Cette situation, certes injuste, invite tout de même à une certaine humilité.
Pourtant, sans ce texte qui sera froissé et jeté (on conserve et on publie rarement ce genre de documents, même lorsqu’un de ses auteurs s’appelait Faulkner, lequel avait fait un peu dans l’alimentaire à Hollywood), il n’est point de film. C’est ce paradoxe qui fait du scénariste un auteur sans objet matériel, puisque celui qu’il a rédigé est un produit d’une toute autre nature. Cette question qui pose un problème quasi ontologique existe depuis la naissance du cinématographe et chaque pays en débat ou s’en accommode selon l’histoire et l’évolution de son cinéma.
Qu’en est-il chez nous, comme on dit dans les colloques après un tour d’horizon (ou un benchmark diraient certains) qui fiche le bourdon et n’invite généralement pas à la comparaison ?
On a souvent évoqué ce débat, avec ou sans colloque, entre deux petits fours, voire d’autres douceurs, et ce, depuis les années 80. La réponse était toujours la même : on n’a pas de bons scénarios pour permettre la production de bons films. Sachant que par bon film on n’entend pas celui qui plaît au public, mais seulement à ceux qui le font. Mais comme ceux qui faisaient les films étaient en majorité ceux-là mêmes qui les réalisaient, on a produit ce qu’on appelle des «films d’auteur». On ne portera ici aucun jugement critique ou esthétique sur les productions qui s’abritent sous cette appellation contrôlée qui nous vient d’ailleurs. Mais force est de constater que ce choix n’a pas drainé les foules ni dans les salles (lorsqu’il y en avait encore par dizaines) ni lors de le diffusion de ces films à la télévision. Résultat des courses, le cinéma d’hier n’a pas suscité des vocations parce qu’il il n’y avait pas de quoi pousser au moindre exercice d’admiration.
On n’a pas donné envie aux jeunes d’apprendre à faire des films, ni aux uns et aux autres de s’exercer aux métiers de l’image et du son. Quant à l’art du scénario, si tant est qu’il en soit un, le problème est autrement plus profond. On ne devient pas scénariste comme on devient licencié en lettres, comme on ne s’improvise pas scénariste parce qu’on sait faire dialoguer deux personnes dans un salon ou en extérieur jour sous un arbre et non loin d’une vache.
L’auteur américain de romans noirs et auteur de scénarios, Raymond Chandler, aimait dire que «s’il n’existe pas d’art du scénario, c’est en partie dû à ce qu’il n’existe pas d’ensemble accessible de données théoriques et pratiques pour l’apprendre». Certes, il y a aujourd’hui des cours, des formations, des ateliers pour affiner quelques techniques, notamment pour la télévision, plus propice au formatage et à l’acquisition d’une certaine efficacité technique facilement mesurable à l’aune des audiences. Mais la question essentielle est de savoir si on peut disposer de scénaristes aguerris ou de talent en l’absence d’une production littéraire en quantité et en qualité suffisantes. Il semble que tous les pays où le cinéma a fait des progrès sont des pays où il existait déjà un foisonnement littéraire, une édition de livre dynamique et donc une matière et des auteurs capables de donner envie de lire et d’écrire pour la littérature ou pour le cinéma, ou pour les deux, comme c’est souvent le cas ailleurs. Or, ici on vient à peine de commencer et déjà on attend du grand et du prestigieux, de la quantité et de la qualité, des salles partout et des festivals dans la moindre bourgade. Certains rêvent même de Cannes et d’Oscars tous les ans. Il nous semble qu’il faudrait raison garder et penser d’abord à construire sur ce que nous avons déjà commencé.
En une dizaine d’années maintenant, le Maroc dispose d’une cinématographie qui est à la hauteur des moyens investis malgré les carences citées ci-dessus. Et comme nous l’avons souvent cité ici à propos de la littérature, retenons ce que Gide disait à ce sujet : «Il faut beaucoup d’histoire pour faire un peu de littérature». Mais pour faire un peu de cinéma, il semble qu’il faudrait encore plus d’histoire et bien d’autres histoires.
