Idées
«Maroc vert» : des questions en suspens
L’enjeu est surtout de ne pas placer la réforme
du secteur dans la perspective étroite de la viabilité
de l’agriculture mais dans celle, plus large, du développement rural. Un autre enjeu, connexe, mais qui ne semble pas pris en compte dans le plan Maroc vert.
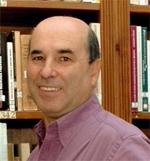
L’agriculture marocaine va-t-elle se donner les moyens de sa renaissance? Il serait temps ! Ce secteur a dû pendant des années lutter non seulement contre les caprices météorologiques et un environnement institutionnel démotivant, mais aussi contre les répercussions nuisibles de l’absence d’un choix politique clairement assumé.
En s’interrogeant sur l’avenir des structures de production agricole, l’étude du cabinet McKinsey tente de discerner l’évolution possible de cette activité, compte tenu des ajustements qui s’imposent face à de nouveaux défis. L’état des lieux n’a rien apporté de nouveau : les atouts, les freins majeurs au développement agricole, les politiques de soutien, les instruments de l’intervention publique, tout ces aspects de la radioscopie avaient déjà fait l’objet d’études approfondies, de rapports pertinents.
Les McKinsey boys ont largement puisé dans ce gisement d’information et d’analyses, produit, pour une large partie, par les compétences nationales disséminées dans nos institutions de recherche et notre administration. Que de préconisations et de recommandations restées sans suivi par manque de courage politique.
Du point de vue de la stratégie, l’étude McKinsey présente une vision, définit des objectifs, propose des options de politique en vue d’exploiter le potentiel latent du secteur. Le benchmarking, point fort de la démarche, permet des éclairages sur la compétitivité comparée pour mieux asseoir les choix et identifier les besoins de refonte des politiques d’appui et d’encadrement.
C’est sur ce volet que la valeur ajoutée de l’étude est plus marquée. La perspective présentée serait celle d’une agriculture bâtie sur deux piliers. L’un concrètement engagé dans une production animale et végétale performante en partie tournée vers l’exportation, appuyée par une vague d’investissements privés.
L’autre composé des exploitations les plus fragiles, notamment dans les zones périphériques, soutenues par des politiques de reconversion, de diversification et d’intensification et accompagnées d’une approche de lutte contre la pauvreté. La politique agricole a besoin d’être différenciée, ciblée dans ses moyens en fonction des écosystèmes, des spéculations et des types d’exploitation.
La crainte est que la disparité des ressources affectées à l’une ou l’autre de ces composantes ne conduise à creuser le fossé entre, d’une part, les entreprises industrialisées à forte intensité de capital appartenant à des grandes sociétés, et, d’autre part, des exploitations familiales plus traditionnelles. Les premières sont plus susceptibles de l’emporter par des formes intensives d’agriculture dès lors que bon nombre de procédés de production peuvent être pleinement maîtrisés et que l’incidence des fluctuations climatiques peut être réduite au minimum.
Les secondes devraient perdurer dans le domaine de l’agriculture extensive, où les compétences de gestion individuelles sont particulièrement prisées et où la nature des incitations au rendement est plus délicate à porter ses fruits. Ces deux tendances comportent bien entendu de nombreuses variantes. A l’avenir, les exploitations familiales extensives continueront de jouer un rôle de premier plan, mais sous une forme différente. Pour être en mesure de s’adapter plus rapidement à l’évolution du marché, elles devront mieux s’articuler avec les activités de commercialisation et de transformation. Les petits agriculteurs obtiendront de meilleurs résultats s’ils s’appuient sur des partenariats fondés sur des intérêts communs avec les entreprises qui interviennent au-delà du site d’exploitation.
Coopératives ou agrégateurs, ces nouvelles formes de coopération d’ores et déjà répandues dans le secteur devraient gagner du terrain. Mais, au-delà de ces choix, que de questions de fond restent en suspens : la création de l’agence nationale de développement, les projets d’agrégation, la refonte du rôle du ministère et le démantèlement de structures publiques d’encadrement, l’avenir de la recherche agronomique. Des enjeux majeurs qui appellent un vrai débat et une concertation réelle entre les parties prenantes.
Dans la mise en œuvre des préconisations de l’étude, les autorités politiques seront confrontées à des choix difficiles. C’est sur leur capacité d’agir qu’elles sont attendues par les acteurs et l’opinion publique. Elles auront la délicate responsabilité de trouver l’équilibre, pour chaque filière, entre, d’une part, la nécessité d’introduire plus de concurrence, et, de l’autre, celle de veiller à ce que les mesures prises soient jugées acceptables pour la collectivité. Elles auront, en outre, à tenir compte de la multiplicité des fonctions de l’agriculture, c’est-à-dire de ses dimensions économiques, sociales, environnementales et autres.
Les enjeux de la réforme, aussi importants soient-ils, ne sont pas seulement de libéraliser, de renforcer les signaux du marché ou d’effacer la ligne de partage traditionnelle entre l’agriculture d’un côté et le secteur de l’industrie alimentaire et de la distribution de l’autre. Ils sont aussi et surtout de ne pas placer la réforme du secteur dans la perspective étroite de la viabilité de l’agriculture mais dans celle, plus large, du développement rural. Un autre enjeu, connexe, mais qui ne semble pas pris en compte dans l’étude. En faut-il encore une autre ? Les McKinsey boys ont encore du pain sur la planche.
