Idées
A la recherche des classes moyennes
Elles sont plus éduquées qu’auparavant, mieux diplômées, et leur revenu est plus élevé que celui de la génération précédente, mais, en dépit de tout cela, les classes moyennes ne peuvent atteindre les mêmes objectifs que la génération issue de l’indépendance. Tout cela est paradoxal !
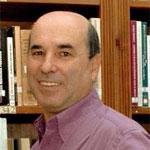
Lathématique des classes moyennes ressurgit depuis quelques semaines, et pour cause : le dernier discours royal a fustigé la bi-polarité «riche-pauvre». Il appelle à ce que les politiques publiques soient vouées à l’élargissement de la classe moyenne. La sortie télévisée du ministre délégué chargé des affaires économiques et générales, lors de l’émission télévisée Hiwar sur la Une, a confirmé l’intérêt nouveau que portera le gouvernement au devenir de cette catégorie sociale.
Le HCP désagrège ses données et affine ses instruments en vue de tracer les contours de cette nébuleuse sociale.
Le concept de classes moyennes, dans une société, est variable et n’est pas facile à définir. On reste souvent perplexe face au manque de précision dans la définition de la notion de classes moyennes, et à l’énumération des enjeux auxquels ces dernières font face. Mais c’est une réalité sociale que l’on reconnaît quand on la voit.
La question gagne en intérêt à mesure que les échéances électorales se rapprochent. Les secteurs moyens de la société sont un groupe ou un ensemble varié de groupes sociaux qui se caractérisent, outre leur niveau de vie – habituellement plus du double du «panier de la ménagère» -, par d’autres traits, une manière de vivre, des niveaux d’éducation, des habitudes de consommation, des lieux de résidence et des aspirations sociales. Ils représentent un élément significatif pour stabiliser des projets politiques en introduisant une zone tampon entre les riches et les pauvres et en favorisant les luttes pour le respect des droits civils, politiques, humains, et pour la qualité de la vie.
D’aucuns considèrent que les classes moyennes marocaines sont en voie de dépérissement. Si elles sont plus éduquées qu’auparavant, mieux diplômées, et que leur revenu est plus élevé que celui de la génération précédente, en dépit de tout cela, elles ne peuvent accomplir les mêmes objectifs que la génération issue de l’indépendance. Elles sont dépréciées. Tout cela est paradoxal ! Elles ont évolué dans un système qui a ouvert plus de perspectives et jamais les dépenses sociales de l’Etat ne furent aussi importantes.
Et pourtant, l’échec est patent. Le premier problème est celui des inégalités, car celles-ci ne se sont guère réduites durant les quatre dernières décennies. Le problème réside aussi dans l’immobilisme forcé des classes moyennes. Si les enfants sortant de familles au capital culturel, économique, et social élevé continuent de s’en sortir, les autres galèrent. L’ascenseur social a perdu de sa puissance.
Les classes moyennes ne s’apparentent pas à un univers social stagnant ou en régression. Les classes moyennes d’hier ne sont pas nécessairement celles d’aujourd’hui. Elles font face à une grande mutation, mais celle-ci est silencieuse, presque imperceptible. En réalité, cette dynamique de décomposition /recomposition n’est pas massive, soutenue.
Ciment d’une société en mouvement, les classes moyennes, si elles tendaient à se désagréger, pourraient entraîner l’ensemble de la société avec elles. Mais, quelles sont-elles exactement ? S’il est vrai que l’étendue des classes moyennes varierait en fonction des outils statistiques dont on userait pour les définir, on retiendra surtout qu’il s’agit du socle central qui représenterait, pour le moment, une faible composante de la population du pays.
L’ambition de tout projet social, de toute politique de développement est d’en étendre la sphère. Or, les politiques économiques menées depuis quelques années viennent infirmer cette ambition. Elles n’ont pas suffisamment appuyé le mouvement ascensionnel incarné par les classes moyennes.
Le corollaire de ce constat est la nécessité d’une remise en cause du modèle profondément inégalitaire, qui montre aujourd’hui clairement ses limites. L’enjeu est de promouvoir le passage d’un modèle de société en sablier – caractérisée par une configuration sociale où la classe riche est étendue, la classe moyenne plutôt réduite et la majorité de la population composée de couches populaires – à un modèle de société en montgolfière où la base des classes populaires serait restreinte, les classes moyennes plus importantes et la classe aisée une minorité.
Dans cette perspective, les politiques publiques ne devraient plus se satisfaire de lutter contre la pauvreté, de colmater les brèches en parant aux urgences sociales. C’est d’un nouvel Etat-providence que le Maroc a besoin, d’une politique cohérente conciliant les impératifs de la compétitivité économique et ceux de la cohésion sociale. Une politique portée par les exigences de l’effort au travail et de la solidarité. Dans la ligne de mire, l’éducation nationale, car l’avènement des classes moyennes est surtout celui du savoir.
Mais le système éducatif n’est pas seul en cause. Il y a aussi l’emploi, la protection sociale, la fiscalité, le coût du crédit. En somme, des politiques publiques qui tendent à promouvoir une représentation souhaitée de la stratification sociale.
