Affaires
Comment on a tué l’industrie du poulpe
De 107 000 tonnes en 2000, les prises sont passées à 16 000 tonnes.
Le poulpe est en voie d’extinction.
L’INRH tire la sonnette d’alarme : l’arrêt biologique
sera prolongé au moins jusqu’en avril.
L’Etat porte une lourde responsabilité dans la dégradation
de la situation du secteur.
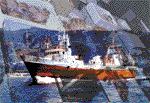
Début mars 2002. A 20 miles nautiques de Dakhla, la pêche au poulpe vient de reprendre après l’arrêt biologique de rigueur. Etrangement, aucun chalutier n’a pris la mer à l’exception de trois d’entre eux appartenant à la société Somathon. Les autres sont immobilisés dans les ports d’Agadir, Tan-Tan et Dakhla à cause de la grève des marins. Les équipages des trois chalutiers se frottent les mains à l’avance. Après trois mois d’arrêt biologique, ils vont pouvoir pêcher seuls dans la zone et s’attendent donc à faire la prise du siècle. Premier jour, 400 kg. Peu, trop peu ! On change de coin et on recommence. Deuxième jour, un peu plus que la veille. Les marins n’en croient pas leurs yeux. Cette fois-ci c’est peut-être vraiment la fin : il n’y a plus de poulpe, en tout cas pas assez. On est loin des 10 tonnes par jour pêchées au début des années 1990.
Ceci s’est passé il y a plus d’une année. Aujourd’hui, c’est pire. Selon les chiffres officiels, à fin août dernier, le total des captures de poulpes, toutes pêcheries confondues, s’élèvait à 16 000 tonnes. Un chiffre qui ne risque pas de changer d’ici à décembre puisque la pêche au poulpe est arrêtée.
Il y a donc péril en la demeure. Malgré plus de 21 mois d’arrêt biologique pendant les 3 dernières années, soit en moyenne 7 mois par an, le poulpe ne se régénère pas suffisamment. «C’est une des pires années qu’on ait eues, depuis plus de dix ans, en termes de captures», déplore un haut responsable au ministère des Pêches qui se rappelle qu’il y a quelques années, «les captures avaient atteint le creux de la vague avec 24 000 tonnes». A voir les chiffres des prises, on semble se diriger vers une extinction assurée du poulpe : 107 000 tonnes en 2000, 96 000 en 2001, 57 000 en 2002 et juste 16 000 cette année.
C’est ce qui explique qu’à la mi-octobre, alerté par l’Institut national de la recherche halieutique (INRH), le ministre des Pêches, Tayeb Rhafès, ait décidé de prolonger l’arrêt biologique de deux autres mois alors que les bateaux devaient quitter les ports début novembre. Une mesure qui, bien entendu, n’a pas été du goût des armateurs.
Des mesures qui auraient dû être prises en juin déjà
Une première réunion, tenue le 22 octobre entre le ministre et les professionnels, s’était très mal passée. Ces derniers en sont sortis «abattus» face à ce qu’ils considèrent comme «un manque d’imagination» de la part du ministère de tutelle. En gros, ils lui reprochent de «sortir le joker de l’arrêt biologique, une cautère sur une jambe de bois, car cela n’empêchera pas l’extinction de la ressource. L’arrêt biologique n’est pas respecté par tout le monde». Au ministère, on reconnaît du moins un fait: en 2000, avec 2 mois seulement d’arrêt biologique, la pêche a été de loin meilleure qu’en 2003 où il y a eu sept mois de repos forcé.
Il aura fallu attendre une seconde réunion, tenue mercredi 5 novembre, par le Premier ministre avec le ministre des Pêches, puis le 7 novembre avec les professionnels pour en arriver à l’application prochaine de mesures concrètes : interdiction prolongée de la pêche au poulpe, destruction des barques artisanales illégales, politique de quotas, et contrôle renforcé. Beaucoup de ces mesures étaient cependant connues. Elles avaient fait l’objet d’une réunion entre les professionnels et le département de tutelle le 12 juin dernier…mais ne sont pas encore mises en œuvre. Car tout le problème vient d’une surexploitation de la ressource. Selon l’INRH, l’effort de pêche dépasse de 50% les capacités offertes.
Comment en est-on arrivé là ? Pour le comprendre, il faut revenir au milieu des années 1970, époque à laquelle la flotte hauturière moderne commença à se développer, comme le souhaitait feu Hassan II.
Les observateurs avisés savent en fait qu’à l’époque la création d’un secteur moderne de pêche hauturière a été la conséquence d’une conjonction de faits. D’abord, le Maroc voyait là une occasion de peupler les provinces du Sud.
La ruée non contrôlée vers l’or blanc
Ensuite, il faut rappeler qu’en 1976 et 1977, les banques européennes avaient atteint un niveau de surliquidité dangereux après l’explosion des pétrodollars suite au choc pétrolier. En parallèle, plusieurs chantiers navals d’Espagne et de France étaient en faillite. L’idée du défunt Roi tombait à point nommé pour arranger les affaires des uns et des autres. Des licences furent accordées, des financements trouvés et des commandes passées. La pêche hauturière prit alors son essor pour atteindre le nombre de 288 unités, avec un apport substantiel en devises pour le pays. Des pics de 600 millions de dollars (6 milliards de DH) furent atteints avec une moyenne sur 10 ans de 400 millions par an. Tout le monde y trouvait donc son compte et tout se passa comme prévu jusqu’à ce que, au début des années 1990, le phénomène des barques fît son apparition ou, plutôt, quand on découvrit que même les petites barques pouvaient pêcher du poulpe qui de surcroît était commercialement plus intéressant que le pélagique. Au fil des mois, ce fut une véritable ruée sur les barques pour pêcher le poulpe. Aujourd’hui, à côté des 288 unités de pêche hauturière, environ 12 000 à 15 000 barques artisanales pêchent le poulpe. Parmi ces barques, 5 000 seulement sont réglementées. Cela, sans oublier les 350 bateaux de pêche côtière qui ont été autorisés à opérer eux aussi dans le secteur.
200 millions de DH par an pour un contrôle inefficace
Et, vraisemblablement, ce sont aujourd’hui ces barques, qu’elles soient légales ou non, qui posent le plus problème car leurs propriétaires ne respectent pratiquement jamais les arrêts biologiques ni les zones interdites. Des professionnels expliquent que, «pour des raisons politiques et populistes, certains ministres ont délivré un nombre excessif de licences à la pêche artisanale en mettant en avant la réussite dans le domaine de la création de l’emploi». Utilisant des engins appelés «poulpiers» et pêchant très souvent à proximité de la côte, ces barques se sont attaquées de fait aux poulpes juvéniles et aux géniteurs, mettant en danger le cycle de reproduction. Ceci ne diminue en rien la responsabilité des autres filières notamment côtière et hauturière. Ces dernières auraient, elles aussi, contribué à la dégradation des ressources en utilisant des doubles maillages, des chaluts non réglementaires ou encore en pêchant dans des zones interdites.
Le résultat est là, aujourd’hui reconnu par toutes les parties. A l’image de Tijani Rhanmi, secrétaire général du ministère, qui lâche sur un ton déconcerté que «la ressource halieutique est au bord de l’effondrement». Quand un spécialiste parle d’effondrement de la ressource, il faut comprendre que c’est réellement la catastrophe. «La ressource halieutique appartient à tous les Marocains et nous avons le devoir en tant qu’administration de la protéger», continue M. Rhanmi, commentant la décision du ministre de prolonger l’arrêt biologique jusqu’au mois de janvier sur la base d’un rapport de l’INRH. Mais la reprise de la pêche reste conditionnée par l’amélioration de l’état de la ressource. L’INRH devra donc refaire d’autres tests pour dire si, oui ou non, les chalutiers pourront sortir. Les hauturiers se disent prêts à respecter la décision à condition que toutes les parties s’engagent à faire de même. C’est la raison pour laquelle on fait savoir au ministère que le temps de la tolérance et de la complaisance est terminé. Dorénavant, les barques illégales seront démontées et brûlées et celles qui ont des licences rigoureusement contrôlées. Un engagement déjà pris, faut-il le rappeler, en juin dernier. Et dire que l’Etat dépense chaque année près de 200 millions de DH justement pour contrôler les unités de pêches dans la région de Dakhla et Laâyoune.
Où en est-on aujourd’hui? Suite à la réunion avec le Premier ministre, une commission a été formée pour étudier et proposer, dès la semaine prochaine, un plan d’action. Simultanément, le ministre des Pêches se rendra dans une semaine à Dakhla et Laâyoune pour s’enquérir de la situation sur le terrain.
Flotte côtière : 100 bateaux autorisés au lieu de 300
Mais les premières mesures ne devraient pas tarder à tomber, à commencer par la destruction des barques illégales et le renforcement du contrôle. A moyen terme, l’administration ne doute pas qu’il faudra réduire le nombre de navires qui pêchent le poulpe. A côté des milliers de barques artisanales, les pouvoirs publics comptent réduire la flotte côtière de 300 à 100 unités. Autres mesures préconisées: l’instauration de quotas individuels par bateau, la multiplication des petites zones d’interdiction où le poulpe se reproduit. Pour les unités qui seront écartées, les autorités pensent à leur reconversion dans d’autres espèces, notamment le merlu noir pour la hauturière, et le pélagique pour la côtière. Le principe de reconversion sera également proposé aux centaines d’usines de congélation de poulpe qui sont presque à l’arrêt à Dakhla et Laâyoune. Mais la réussite du plan d’action étant tributaire de l’entente de toutes les filières, il n’est donc pas près de voir le jour puisque la polémique risque d’éclater. En effet, les professionnels de la pêche côtière ont annoncé la couleur en faisant savoir qu’ils refusent catégoriquement la réduction du nombre d’unités. Contacté par La Vie éco, Abdelkrim Foutat, président du Groupement des Armateurs de la pêche côtière, a dénoncé les manœuvres malsaines «des lobbies de la pêche hauturière et ceux de la pêche artisanale».
Dans tous les cas de figure, il faudra attendre fin décembre pour savoir qui pourra sortir pêcher, dans quelles zones et avec quels quotas. Et il se peut même que tous les chalutiers restent cloués au port, puisque l’INRH a demandé un arrêt d’une année au moins. Toutefois, il est plus probable que la pêche reprenne d’ici avril ou mai 2004
