Carrière
Les grilles des salaires : Entretien avec Achraf Dahbi Consultant senior au sein du cabinet LMS ORH
Les postes stratégiques restent à des niveaux de rémunérations importants. Le package type d’un dirigeant marocain est dominé par les éléments à court terme.
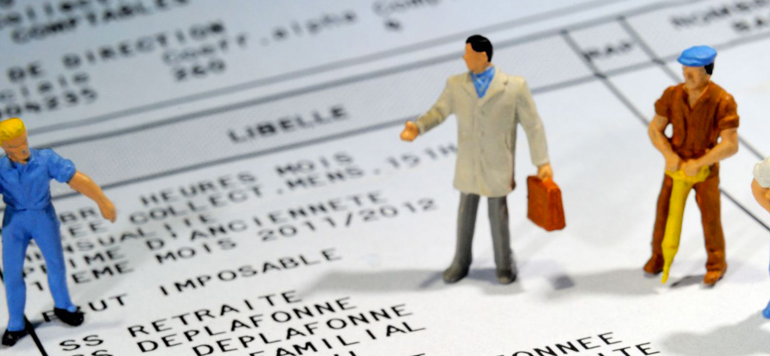
Combien perçoit un DG, un directeur commercial, un DRH ou un acheteur ? Selon la taille ou le secteur, les écarts peuvent être significatifs. En d’autres termes, les politiques salariales ne sont pas uniformes. Toutefois, les postes de management sont de plus en plus valorisés, souligne Achraf Dahbi, consultant senior au sein du cabinet LMS ORH, qui explique la méthode suivie pour la réaliation de l’enquête et met en évidence les résulats obtenus.
Quels sont les faits marquants de cette nouvelle enquête de rémunération ?
L’édition 2017 de l’enquête LMS s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions depuis 25 ans. Nous avons essayé toutefois de raccourcir le cycle de récolte et de traitement pour pouvoir proposer des résultats exploitables en plein période d’augmentation de salaires. Pour cela, nous avons revu nos supports de collecte des données et nous avons mis à la disposition des entreprises participantes nos consultants pour un accompagnement de proximité. Il est vrai aussi que cet exercice est facilité par le fait que nombre d’entreprises participantes sont également nos clients sur les missions de conseil ou de recrutement. Notre approche permet ainsi une stratification pertinente des données en vue de repérer facilement les niveaux de comparaison. Le principal intérêt est de s’approcher davantage des attentes des décideurs.
En termes de restitution, en plus de la restitution chiffrée des résultats, nous avons introduit cette année des analyses plus qualitatives par rapport aux tendances d’évolution des métiers présentés. Ceci permet une lecture plus nuancée des résultats et de se projeter par rapport au futur de certaines fonctions impactées par la digitalisation ou par la mutualisation des périmètres.
Quels sont les postes les plus attractifs en matière de rémunération ?
Nous constatons depuis quelques années un regain de forme pour les métiers de management. Les entreprises se sont suffisamment outillées, que ce soit en termes de process ou d’infrastructures techniques, pour pouvoir maintenant se pencher sur la préservation et l’optimisation des actifs organisationnels. Les entreprises ont besoin aujourd’hui de profils capables d’anticiper sur le marché et surtout de gérer les talents. C’est ainsi que les métiers des RH continuent de bénéficier d’un vent favorable. Un DRH par exemple est aujourd’hui à des niveaux de rémunérations pouvant atteindre 80 000 DH nets de salaire mensuel, voire plus. Les métiers du commercial continuent d’être parmi les mieux payés, notamment en raison des marchés de plus en plus compétitifs et tendus. La connaissance «secteurs» et «produits» est de plus en plus valorisée. Nous retrouvons également les métiers des achats. Certains acheteurs seniors sur des gammes de produits complexes peuvent atteindre les 30 000 DH nets par mois.
Qu’en est-il des postes stratégiques ( DG, Directeurs commerciaux, DAF, DRH) ?
Les postes stratégiques restent à des niveaux de rémunérations importants. Les top managers sont rares sur le marché et quand ils sont repérés, ils sont bien valorisés. Aujourd’hui, pratiquement toutes ces fonctions font parties des comités de direction (Codir) et leur niveau de rémunération est de plus en plus proche. Un directeur général bénéficie d’un package très compétitif et tout à fait comparable à ses homologues dans des pays plus développés. La comparaison est toutefois à prendre avec prudence au regard du coût de la vie au Maroc et surtout dans les grandes villes. Une étude internationale récente a certes classé le Maroc parmi les pays au coût de la vie plutôt moyen, mais il reste bien devant des pays similaires comme l’Egypte, la Tunisie ou l’Algérie. A noter également que le Maroc se positionne de plus en plus comme un hub africain. La conséquence immédiate est que les fonctions de directions habituellement couvrant un périmètre local deviennent régionales. Ce changement de périmètre s’accompagne d’une évolution importante en termes de rémunération. Dernière remarque et pas des moindres, nous avons constaté qu’au sein des filiales des multinationales, les patrons expatriés sont de plus en plus souvent remplacés par des patrons marocains. Ces derniers bénéficient de packages de rémunérations très équivalents à ceux de leur prédécesseur. Ce qui contribuent aussi à la tendance haussière des salaires des dirigeants.
Quel regard portez-vous sur la politique de rémunération des dirigeants de manière générale ?
De manière générale, le sujet de rémunération des dirigeants est plutôt un sujet de gouvernance des entreprises. Nous remarquons que la réflexion autour de cette thématique est en train de se structurer. Le travail des comités des nominations et des rémunérations se professionnalise. Il faut admettre néanmoins que le chemin à parcourir est encore long. La marché des dirigeants est encore très réduit et intuitu personae. Ceci génère un processus de détermination des packages de rémunérations basé sur un jeu de négociation souvent décorrélé de la réalité économique. Ce qui nous amène au cœur de la problématique. Le package type d’un dirigeant marocain est très porté sur les éléments à court terme : salaire fixe+ bonus+ avantage en nature. En gros, 100% du package est centré sur des éléments monétaire ou équivalent. Cette structure est contradictoire avec la logique de contrat à long terme selon le modèle de l’agence. Dans des pays plus mature économiquement, cette structure est très différente avec plus de 50% du package constitué de dispositif long terme souvent à base de capital (stock option/action de performance,..).
Comment expliquer cela ?
Les raisons d’un tel phénomène sont multiples et nécessitent un développement plus approfondi. Citons simplement une spécificité culturelle marocaine, un modèle actionnarial encore frileux à l’intégration au capital de professionnels externes de management, des marchés financiers peu encourageants et efficients et enfin un cadre fiscal et juridique peu favorable au développement de ce type d’instruments.

