Idées
Si Homère nous était compté…
Pour expliquer l’origine de la vie et des hommes, les Grecs ont inventé des récits et des mythes, comme l’écrit le grand spécialiste de la mythologie, Jean-Pierre Vernant, au début de son excellent petit livre, L’Univers, les dieux et les hommes (Point. Essai). Les religions ont mis fin à cette explication en datant l’origine et en mettant l’homme au centre de la scène de l’histoire pendant que le Créateur est aux mannettes.
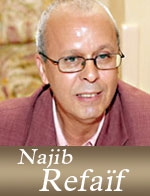
Tout en expulsant certains mythes comme autant d’éléments perturbateurs, elles en ont repris certains et en ont créé ou réécrit d’autres. Le reste, et jusqu’à nos jours, a été fondé par les hommes, leurs prophètes et leurs exégètes, selon les croyances des uns et les interprétations des autres. Quant à l’histoire et aux historiens, qui eux pourtant travaillent sur des documents et donc sur «du vrai», ils n’ont pas fait autre chose qu’écrire des récits. En effet, à la question «Qu’est-ce que l’histoire ?», le grand historien Paul Veyne répond et explique dans Comment on écrit l’histoire, par cette jolie et limpide définition, que nous avons déjà citée et que nous reprenons encore une fois pour les besoins de la cause : «Les historiens racontent des événements vrais qui ont l’homme pour acteur ; l’histoire est un roman vrai». Plus loin, Paul Veyne explique ce qu’est un récit véridique, avec ses intrigues et ses rebondissements, compare l’origine du roman à celle du récit historique, analyse la culture de l’historien et, en conclusion, expose et discute le progrès de l’histoire et l’évolution de sa critique dans une archéologie, celle du savoir telle que Michel Foucault l’a baptisée dans son livre éponyme. Car pour Veyne, «toute histoire est archéologique par nature et non par choix». Et pour expliquer et expliciter, il faudrait l’appréhender tout entière et la croiser avec toutes les autres disciplines, pratiques et savoirs qui l’environnent.
C’est en relisant ce passage, pour un tout autre usage que cette chronique, qu’une information locale rapportée par un quotidien en langue arabe a attiré mon attention. Il s’agit de la protestation de certains parents d’élèves d’un lycée dépendant de la Mission, dans le sud du pays, contre un cours ayant pour sujet la comparaison entre l’épopée de Gilgamesh et le mythe du Déluge et de Noé. Le journal a fait état de l’inquiétude de ces parents quant à une confusion chez leur progéniture entre cette légende ou ce mythe et leur religion d’origine. On croit rêver ! Comment peut-on choisir d’éduquer et d’instruire ses enfants, les pousser à acquérir savoir et connaissances, qui plus est dans une école de la Mission, et refuser un cours basic sur la thématique «Art, mythes et religions», dont le but est de «sensibiliser les élèves au fait religieux et de leur faire découvrir, en liaison avec la lecture des textes des œuvres d’art antique et moderne» ? Car c’est bien l’objectif d’un tel cours. On ne sait qui du mythe du Déluge, lequel est cité dans les trois religions monothéistes ou de la légende de Gilgamesh, a provoqué le courroux de ces parents. Selon toutes les notices, Gilgamesh est un roi à demi-légendaire de la cité D’Ourouk (Uruk ou Irak actuel) qui aurait régné plus de 3000 ans avant l’Hégire. Le récit qui rapporte cette légende est d’origine sumérienne et parle d’un monarque nommé Gilgamesh (celui qui a tout vu) et qui fut un héros despotique et humain et dont les exploits rappellent ceux d’Ulysse ou d’Héraclès. Selon les récits, il est dieu pour deux tiers, et homme pour un tiers. Ce sont probablement ces proportions «blasphématoires» qui auraient «ébranlé» le savoir de certains parents. Ces derniers devraient lire l’ouvrage de Vernant sur l’origine des mythes et celui de Veyne pour l’histoire ainsi que d’autres ouvrages sur le fait religieux. Car il s’agit ici du fait religieux comme objet d’études et non de la religion comme une affaire de foi et de spiritualité. Enfin, ils liraient aussi avec profit, ce que nous leur souhaitons, la belle épopée de Gilgamesh, racontant la longue et vaine quête d’immortalité, faite de souffrances et d’errance, puis la prise de conscience et le retour vers la sagesse. La morale de cette légende, comme souvent celle d’un bon nombre de mythes et de légendes, n’est guère éloignée de ce que toutes les religions révélées prescrivent. Mais pour le savoir encore faut-il entreprendre une autre quête tout aussi difficile que celle de Gilgamesh : celle de la connaissance, de la pensée et de l’esprit. Car les mythes ne sont pas que des récits, ils contiennent d’inépuisables richesses de pensées, de culture et de préceptes moraux qui accompagnent l’humanité depuis que l’homme d’est mis à penser et à raconter. Dans sa lecture de l’Iliade et l’Odyssée (Bayard. Collection : la mémoire des œuvres), Alberto Manguel, l’auteur de la célèbre œuvre «L’Histoire de la lecture» parvient à ce constat : «Homère est une énigme. Puisqu’il n’a pas d’identité démontrée et que ses livres ne révèlent aucun indice clair concernant leur composition, il peut supporter, à l’instar de son Iliade et de son Odyssée, un nombre infini de lectures». C’est souvent ce nombre infini de lectures qui déstabilise ceux qui n’ont qu’une certitude et une seule vérité, la brandissent, s’y accrochent et veulent y accrocher le reste de l’humanité.
