Idées
Des ententes en béton
Nos cimentiers sévissent dans un marché cartellisé, sans que les indices de pratiques anticoncurrentielles dans cette activité ne fassent l’objet d’un examen approfondi.
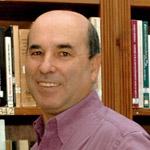
De tout temps et en tout lieu, les entreprises ont cherché à forger des alliances destinées à leur assurer une position de domination sur leurs marchés respectifs. La pratique est ancienne, puisqu’elle était déjà dénoncée par Adam Smith dans son Enquête sur la richesse des Nations : «Les gens du même métier se rassemblent rarement, même pour se divertir et prendre de la dissipation, sans que la conversation aboutisse à une conspiration contre le public ou à quelque invention pour augmenter leurs prix».
Durant l’entre-deux guerres, les cartels ont exercé ainsi une influence sur le commerce mondial et sur le partage de ses bénéfices, avant d’être combattus depuis la fin des années 40. Procédant par des accords formels ou informels, les cartels entravent la libre concurrence en fixant des prix élevés, limitent la production, empêchent la diffusion de leur avance technologique et gèrent de manière coordonnée leurs parts de marché. Récemment, les services européens de la concurrence soupçonnaient les cimentiers de constitution de cartels, d’abus de position dominante et de violations des règles de concurrence européenne.
Lafarge, les Ciments français, le suisse Holcim, les allemands Dyckerhoff et HeidelbergZement, le mexicain Cemex et l’italien Italcementi figuraient parmi les groupes soupçonnés de pratiques anticoncurrentielles. Les inspecteurs de la Commission européenne ont perquisitionné plusieurs sociétés actives dans le ciment et des produits liés, dans plusieurs Etats de l’Union européenne. Un peu partout dans le monde, les autorités de la concurrence se sont vu confier le contrôle des fusions-acquisitions : dans l’audiovisuel, les télécommunications, la finance et bien d’autres activités. Toute entreprise qui opère sur leur territoire, qu’elle soit nationale ou étrangère, doit notifier à l’autorité tout projet important de concentration. Si les refus ne touchent qu’une infime proportion des fusions notifiées, rares sont cependant les projets qui sortent indemnes de l’examen des autorités de la concurrence. Des aménagements sont demandés. Comme la compétition est planétaire, les Autorités fondent toujours plus leurs analyses en fonction du marché mondial, pour faciliter la création des champions nationaux capables de rivaliser avec les poids lourds internationaux. Mais les décisions des autorités sont toujours claires : la concurrence doit jouer à fond. Son but n’est pas de favoriser certains groupes, mais de créer et protéger un environnement économique où la compétition est forte. La concurrence doit pousser les entreprises à être toujours plus performantes. Aux yeux de ces autorités, c’est le meilleur moyen pour rendre les entreprises nationales compétitives au niveau mondial.
Il ressort de la pratique internationale de la régulation des marchés que la libre concurrence doit s’appliquer sans restriction pour le plus grand bien de tous. Au Maroc, ce principe n’est guère contesté par les entreprises comme par l’Etat. Mais, au fond, l’évocation de son application effective fait grincer bien des dents. On le voit, quand nos cimentiers sévissent dans un marché cartellisé, sans que les indices de pratiques anticoncurrentielles dans cette activité ne fassent l’objet d’un examen approfondi. Pourtant la Direction de la concurrence avait diligenté une enquête dont la teneur n’a pas été rendue publique. On le voit aussi quand des processus de fusions-absorptions s’organisent pour renforcer les positions de nos «champions nationaux» dans la finance ou dans d’autres secteurs sans que l’on s’interroge sur les implications de ces mouvements sur les pratiques des affaires dans les secteurs d’implantation. Or, qui dit marché ouvert, dit règles de jeu communes et désignation d’un arbitre chargé de veiller à leur respect. C’est pourquoi dans tous les pays démocratiques, des autorités indépendantes se sont vu confier une mission prioritaire: faire fonctionner justement et équitablement le marché. Le droit de la concurrence est désormais un élément fondamental de la construction d’une économie moderne. Trois principes prioritaires en constituent le socle doctrinal.
Le premier est politique: sans un minimum de règles communes, la transparence et l’efficience économiques n’ont aucun sens. Au même titre que la liberté d’entreprendre. Le second est économique : la lutte contre le cloisonnement des marchés et les actions protectionnistes de l’Etat est censée garantir le bon fonctionnement d’une économie de marché, en empêchant les abus de la puissance économique privée. Enfin, le troisième est social : le droit de la concurrence cherche à protéger les consommateurs et les usagers, en leur proposant l’offre la plus large possible au prix le plus bas possible.
Le Maroc peut-il aspirer, un jour-lequel ?-, à disposer d’une Autorité indépendante de la concurrence, dotée de moyens d’investigation, de pouvoir de sanction à l’encontre des comportements anticoncurrentiels des entreprises (publiques et privées) ? En l’absence d’une telle institution, les accords horizontaux et les cartels entre entreprises, les ententes verticales, tels que les accords contractuels entre producteurs et distributeurs, auront encore une longue vie devant eux.
