Idées
Le voisinage, les tomates et Aminatou
Dans quelques jours, la ville espagnole de Grenade devrait abriter le premier sommet UE – Maroc destiné à couronner le nouveau statut avancé du Maroc. Tout semblait baigner dans l’huile jusqu’à ce que deux grains de sable ne fassent grincer la mécanique…
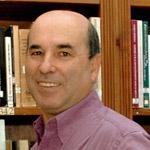
C’est la semaine prochaine que Grenade doit abriter le premier sommet UE-Maroc de l’histoire. Il devrait couronner, au plus haut niveau, le nouveau Statut avancé du Maroc consigné dans le document conjoint adopté en octobre 2008, lors de la septième session du Conseil d’association UE/Maroc. Les deux partenaires avaient décidé de revisiter le cadre contractuel qui les lie et d’anticiper sur la trajectoire future du partenariat en lui ouvrant un nouveau dessein davantage ambitieux.
Des grains de sable, portés par les vents défavorables, semblent perturber le fonctionnement de la belle mécanique mise en marche. Pourtant, tout baignait dans l’huile ou presque. La feuille de route était tracée, il restait à donner du contenu à ce projet pour le démarquer de la check-list établie dans les Plans d’action de bon voisinage. Le Statut avancé ajoutait un socle à l’ancrage commercial, financier et économique des accords précédents. Un socle fort de sa dimension institutionnelle et politique : les partenaires affirmaient qu’ils partageaient les valeurs communes de la démocratie et d’Etat de droit. Il n’y a qu’à parcourir le texte du document conjoint pour constater que l’Europe semblait globalement satisfaite de son partenariat, qu’elle érigeait le Maroc presque en modèle de référence dans un environnement euro-méditerranéen où la confiance et les progrès de la démocratie étaient encore à conquérir. Le Maroc était conforté dans son rôle d’avant-garde à l’échelle régionale, il anticipait également sur le mouvement de l’Union européenne à l’égard de son voisinage immédiat.
Qu’est-ce-qui a fait grincer la mécanique ? Deux événements puérils par leur teneur, mais par forts par leurs implications. Et un environnement interne en régression. Ce qui témoigne, au fait, de la fragilité du processus. Le premier événement est l’Affaire Aminatou Haïdar. On n’a pas fini de compter les dégâts collatéraux provoqués par la gestion peu convaincante de cet acte de provocation que le moins averti des contrôleurs de nos frontières aurait dépisté. Un dossier compliqué par des déclarations marocaines soufflant du chaud et du froid, alternant la fermeté et le recul, donnant l’image désastreuse d’un pays qui cède sous la pression. De quoi donner des ailes à ses adversaires. Et voilà qu’un gouvernement socialiste, l’un des plus favorables au Maroc depuis 1975, qui a accueilli favorablement la proposition d’autonomie interne des provinces du Sud, subit la pression de l’opinion publique espagnole mobilisée par des médias hostiles et une société civile chauffée à blanc contre la position marocaine sur le Sahara. C’est peu de dire que l’affaire Haïdar a radicalisé encore plus l’opinion espagnole, et rendu pratiquement intenable la position très modérée du gouvernement Zapatero, en mauvaise passe par ailleurs dans les sondages.
Le second événement est la conclusion de l’accord libre-échange agricole fin décembre 2009. La protestation de milieux agricoles espagnols contre l’accord est vive. L’accord n’est en fait qu’un procès-verbal qui exige encore une ratification des deux parties. Déjà, l’Espagne, qui assure la présidence de l’Europe, a annoncé que ce procès-verbal ne serait ratifié qu’après la fin de la période de sa présidence européenne. L’Espagne craint d’être affectée par quelques concessions ou quotas de tomates ou autres produits. Pourtant, une partie des exportations marocaines dans certains segments des fruits et légumes (fraises, tomates, produits maraîchers) sont réalisés par des producteurs espagnols installés au Maroc (entre 12 et 15% dans certains produits). L’ouverture des marchés pourrait aussi stimuler les exportations espagnoles sur le Maroc, là où les besoins sont forts et grandissants sur des produits de base mais aussi dans le secteur des produits agricoles transformés. Etonnante fermeture d’un partenaire qui exporte au Maroc plus qu’il n’exporte en Chine et Inde confondus, pour qui le marché marocain absorbe plus de produits espagnols que les marchés de tous les pays du Mercosur confondus (Chili, Bolivie, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay), plus que le Mexique, plus que la Turquie.
Ces deux événements auraient-ils eu autant de résonance dans les enceintes communautaires, notamment le Parlement Européen s’ils n’intervenaient sur un fond de reflux des acquis des libertés au Maroc ? Le Statut avancé prenait acte de l’évolution des réformes au Maroc. Le recul enregistré, ces derniers mois, sur la question des libertés fondamentales va à l’encontre de l’annonce de son enracinement dans la culture des droits humains. De quoi donner du grain à moudre à ceux qui, tapis dans l’ombre, n’ont jamais cru, ni peut-être même accepté les progrès du Maroc sur ce terrain. Deux événements et un environnement qui soumettent le succès de cette stratégie à un certain nombre d’hypothèses et facteurs de risques. Les maîtriser est une condition nécessaire pour redresser le cours des choses. Tout d’abord, en donnant de la profondeur à la conjonction des intérêts stratégiques européens et marocains. Celle-ci existe a priori globalement, mais elle peut être fragilisée par des incompréhensions ou des contentieux qui perdurent. Elle suppose en outre une capacité des partenaires, pas toujours évidente, à s’inscrire concrètement dans une perspective stratégique. Ensuite, en donnant au partenariat équilibré un contenu effectif ; cela ne concerne pas seulement les échanges commerciaux non réglés encore (produits agricoles, services en particulier) mais aussi en forgeant une approche commune sur les questions des valeurs partagées et de la sécurité. Le risque de rupture d’équilibre du partenariat est réel si des instances européennes font privilégier la conditionnalité sur le dialogue. Puis en veillant à la cohérence des positions entre le bilatéralisme et le multilatéralisme : le Statut avancé ne peut avancer si le pays de proximité, à quelques encablures de nos frontières, ne s’érige pas en locomotive du partenariat et choisit de transférer vers l’Europe la gestion des tensions bilatérales. Enfin, c’est en renforçant la modernisation de nos institutions et en garantissant une évolution irréversible vers l’Etat de droit que le Statut avancé sera une ambition marocaine.
