Idées
Le dilemme du prisonnier de Copenhague
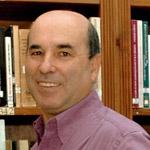
La capitale danoise est en ébullition. Il y a de quoi. Il ne s’agit pas moins que de mettre en musique la coopération internationale, pour sauver ce qui peut l’être de la lutte contre le changement climatique. Une menace qui pèse lourdement sur la survie de l’humanité. Un danger reconnu, il y a déjà presque vingt ans, lors du sommet de Rio en 1992. Mais depuis peu a été fait, au-delà des discours, pour éviter la catastrophe : les émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique, se sont même encore accrues de 38% à l’échelle mondiale depuis 1990. Le protocole de Kyoto, péniblement entré en vigueur en 2005, n’a pas été respecté par nombre de ses signataires. Pourtant les engagements étaient modestes au regard de ce qu’il faudrait faire dans les prochaines années. Le Groupement intergouvernemental d’experts sur le climat, le groupe de scientifiques qui assiste les négociateurs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), révise à la hausse ses prévisions : au lieu de 1 à 3,5° C, la température de l’atmosphère terrestre devrait progresser de 1,4 à 5,8° C d’ici 2100. Avec toutes les conséquences supplémentaires sur la fonte des glaciers, la montée du niveau des mers, l’avancée des déserts, la multiplication des tempêtes… Une situation totalement inédite, puisque, depuis 10 000 ans, la température de l’atmosphère terrestre n’a jamais varié de plus de 1° C en un siècle.
Pour l’instant, rien n’est en effet convenu, au plan international, pour l’après-2012. Or, même si le protocole de Kyoto était intégralement respecté à cette date, la question de l’effet de serre n’en serait pas (du tout) résolue pour autant. Les scientifiques indiquent qu’il faudrait réduire l’ensemble des émissions d’au moins 50 % pour simplement stabiliser d’ici la fin du siècle la teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère. Or, le protocole de Kyoto ne prévoit qu’une réduction de 5,2 % pour les seuls pays industrialisés, lesquels ne représentent que la moitié des émissions mondiales, en forte croissance au Sud.
Longtemps les premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, jusqu’à ce qu’ils soient récemment détrônés par la Chine, les Etats-Unis n’ont jamais accordé leur soutien au protocole. La décision de George W. Bush a jeté la consternation dans le monde entier. Elle a renforcé l’image d’arrogance et d’unilatéralisme de la superpuissance américaine. Pourtant, il faudra bien trouver rapidement les moyens d’impliquer de nouveau les Etats-Unis dans la lutte contre l’effet de serre. C’est que les Américains pèsent en effet à eux seuls près de 45 % des émissions de gaz à effet de serre des pays parties prenantes au protocole de Kyoto (et 25 % du total mondial)… La lutte contre l’effet de serre pourra-t-elle être sauvée au cours des négociations actuelles ? Malgré l’arrivée au pouvoir de Barack Obama, rien n’incite à considérer pour l’instant que le sommet permettra de dépasser les blocages. L’Europe a bien sûr raison de dénoncer l’attitude américaine, mais elle n’a pas montré que le blocage américain ne l’empêchait pas d’agir de façon déterminée pour limiter chez elle les émissions de gaz à effet de serre. L’UE n’a pas été en mesure de tenir ses propres engagements, pourtant nettement plus limités. Elle n’a pas non plus fait preuve de suffisamment de savoir-faire diplomatique pour rassembler le Japon, la Russie et les pays du Sud, afin de sauver le protocole de Kyoto.
Les mécanismes de flexibilité, qui permettent aux pays récalcitrants de tenir leurs engagements, n’ont pas donné les résultats attendus ; sans avoir à mener en dix ans un improbable bouleversement de la société et de l’économie américaines. Il en est ainsi des permis d’émissions négociables, qui permettent de prendre en compte dans le quota d’un pays des réductions d’émissions réalisées ailleurs, et notamment au Sud. Il en est de même, avec les «puits de carbone», c’est-à-dire la prise en compte des actions de reforestation à concurrence de la quantité de carbone contenue dans les arbres. Une question très controversée, car le stockage de carbone réalisé n’est pas forcément durable, du fait, notamment, des incendies de forêts.
Une nouvelle étape décisive de lutte contre le réchauffement climatique se joue au sommet de Copenhague. Les négociations vont-elles déboucher sur un accord international ? Impossible de le dire à ce stade. On connaît les outils économiques qu’il faudrait mettre en œuvre – normes, interdictions, taxes, permis…- pour amener les différents acteurs à changer de comportement. On sait surtout qu’il faudrait en priorité réduire drastiquement l’intensité énergétique de nos modes de production et de consommation. C’est en fait sur cette dynamique socio-économique que l’on bute. Les changements qu’elle appelle impliquent des investissements très coûteux. Il s’agit en effet de renouveler le parc de véhicules et d’appareils ménagers, de modifier profondément l’infrastructure de transports, l’urbanisme des villes, l’architecture des logements et des bureaux… Des évolutions qui demandent des ressources et du temps. Et pour atteindre l’objectif, le renforcement de la coopération internationale est plus que jamais nécessaire. Or, dans un monde extraordinairement inégalitaire et dépourvu d’un mode de gouvernance solidaire, il est très difficile de mettre d’accord les Etats sur la répartition de l’effort à déployer. Le partage du fardeau implique avant tout de résoudre le «dilemme du prisonnier» du développement durable : collectivement, nous avons tous intérêt à modifier nos habitudes de consommation, tandis qu’individuellement nous avons intérêt à les perpétuer.
