Idées
L’évaluation des politiques publiques : une ardente obligation
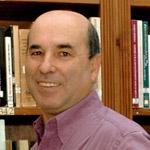
Pendant longtemps manquait trop souvent aux politiques publiques une définition suffisamment précise des objectifs poursuivis. L’énoncé des objectifs dans les lois ou les programmes, quand ils étaient mentionnés, se contentaient souvent de déclarations d’intentions très vagues. On déplorait l’absence d’indicateurs de moyens et de résultats. Quand ceux-ci étaient présentés, les commentaires qui les accompagnaient ne permettaient, en général, pas d’apprécier leur portée. Depuis quelques années, les politiques publiques gagnent en visibilité. Elles s’expriment aujourd’hui dans des Contrats-Programmes, structurés en des axes d’intervention, appuyées par des mesures d’accompagnement et ornementés d’objectifs chiffrés. Des conventions répartissent les rôles entre des parties prenantes, clarifient les engagements et scellent des pactes entre partenaires. Les récents plans sectoriels (Maroc Numeric 2013, Maroc Bleu, Plan d’Urgence) en sont les dernières manifestations. Cette nouvelle démarche représenterait un progrès si, mais seulement si, se déploie un suivi-évaluation de sa mise en œuvre. Or, force est de constater que le défaut de suivi systématique des politiques publiques ne plaide pas toujours en faveur de la crédibilité des nouveaux programmes ou plans d’action. Le peu d’attention portée aux questions concrètes de gestion et d’accompagnement des politiques publiques connaît d’abondants exemples, qu’il s’agisse de l’empilement des lois, de la multiplication des Contrats-Programmes ou encore du foisonnement de conventions… Cette situation reflète des difficultés majeures d’administration des politiques publiques dont les problèmes de suivi ne sont qu’un volet. On peut admettre que dans un contexte de globalisation et de crises économiques et sociales, l’intervention publique fasse l’objet de remises en cause, d’ajustements des programmes ou des Plans d’action en cours. Toute politique se déploie dans un contexte marqué par des impondérables ou des comportements en mal d’adaptation aux mutations de l’environnement. La complexification des problèmes joue, mais elle n’explique pas à elle seule le manque de suivi. L’art de la gestion est justement de tendre à organiser les conditions d’une meilleure maîtrise par le politique du processus de décision publique, en s’efforçant de desserrer la contrainte associée à la décision. L’un des apports du suivi-évaluation des politiques publiques peut précisément consister à prévenir ou corriger les effets des contraintes financières ou institutionnelles insuffisamment appréhendées. Malheureusement, l’intégration des préoccupations d’évaluation dans les ministères est restée extrêmement improvisée. On peut y voir le témoignage de la faible efficacité et du caractère fréquemment velléitaire des tentatives d’organisation du développement de l’évaluation dans les départements ministériels. La situation apparaît aujourd’hui fortement contrastée mais, dans l’ensemble, la fonction d’évaluation des politiques publiques reste mal intégrée au sein des ministères. Quand il en va autrement, les quelques exemples des ministères où l’évaluation est relativement développée, montrent encore que les travaux d’évaluation ne réunissent alors que rarement les propriétés essentielles sans lesquelles l’apport des travaux d’évaluation au pilotage des politiques publiques est, à la fois, indéterminable et, de toute façon, limité. On peut partir du constat factuel que nombre des organismes présumés contribuer à l’évaluation des politiques publiques font, en réalité, tout autre chose. Sont rangées sous cette bannière, fréquemment des missions de contrôle, dans le meilleur des cas des missions d’études, voire, dans la pire des situations, de simples opérations de suivi de gestion. Cette situation peut être la traduction du défaut d’une volonté réelle de développer l’évaluation des politiques publiques, au-delà des intentions affichées. L’évaluation s’impose comme réponse pertinente à la mal-gouvernance de la décision publique. La crédibilité, la légitimité et l’autorité du discours des pouvoirs publics en dépendent fortement. Ce sont ses dispositifs qui pourraient permettre d’augmenter le degré de rationalité des systèmes d’action face à des réalités complexes. Les énoncés d’objectifs, même quand ils sont accompagnés de statistiques et d’indicateurs, n’y suffisent plus. Il y a manifestement un besoin de favoriser le développement d’une «culture de l’implémentation», attentive aux écarts qui s’introduisent nécessairement entre les intentions, leur mise en pratique, et les effets qui en découlent. Elle s’impose pour augmenter la motivation et les compétences des agents publics et de leurs partenaires. En facilitant les échanges d’information et la coordination des intérêts d’acteurs autonomes, elle peut jouer un formidable rôle dans la médiation, l’engagement et l’appropriation effective de l’action publique partenariale. Il existe aujourd’hui une conviction partagée pour reconnaître à l’évaluation des politiques ou des actions publiques le statut d’ardente obligation qui fut, un temps, celui du Plan.
Cette conviction est assurément très réconfortante pour tous ceux qui sont attachés à la promotion d’un modèle de décision publique plus rationnel et plus démocratique. Quand les voix s’accordent pour défendre un instrument de rationalité, de transparence et de responsabilité des actions publiques, on a du mal à comprendre où réside donc le blocage à son institutionnalisation ?
