Idées
Gouverner, c’est prévoir
l’économie nationale est de plus en plus ouverte et donc de plus en plus sensible aux influences extérieures.
Les facteurs monétaires
et financiers sont aussi
sources de problèmes.
Les conjoncturistes ont tendance à croire que s’ils font une erreur grave, l’erreur serait
d’origine monétaire.
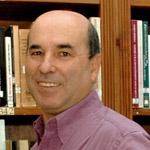
«Gouverner, c’est prévoir» : la formule de Pierre Mendès-France est célèbre. Dans ces conditions, une bonne prévision est indispensable à un gouvernement qui a l’ambition d’influencer directement le cours des événements. Les entreprises se montrent aussi de plus en plus demandeuses de prévisions économiques. Pourtant, la prévision économique n’a pas très bonne presse chez nous. Il est vrai que les prévisionnistes commettent, naturellement, des erreurs d’appréciation. Pourquoi leur métier est-il si difficile ? Les astronomes ne sont-ils pas capables de calculer des siècles à l’avance le début d’une éclipse de soleil à quelques secondes près ? Et sans jamais se tromper. Certes, mais les mouvements des astres obéissent à des lois physiques très précises. De plus, ils ne sont pas perturbés par des phénomènes parasites de toutes sortes. Dans le domaine de l’économie, ces conditions ne sont évidemment pas remplies. Il n’existe pas de lois comme celle de l’attraction universelle, ou, si c’est le cas, nul ne les connaît. Il existe seulement des régularités qui résultent des conditions institutionnelles et d’une certaine permanence des comportements humains. Une permanence toute relative, puisqu’à chaque période de nouveaux facteurs interviennent. Aujourd’hui, des facteurs d’instabilité sont venus s’ajouter. Ainsi, l’économie nationale est de plus en plus ouverte et donc de plus en plus sensible aux influences extérieures. Les facteurs monétaires et financiers sont aussi sources de problèmes. Les conjoncturistes ont tendance à croire que s’ils font une erreur grave, l’erreur serait d’origine monétaire. Plusieurs raisons se conjuguent pour cela. D’abord, il faut du temps pour comprendre ce qui se passe dans la sphère financière : les diverses masses monétaires évoluent de manière contradictoire, il faudrait avoir une vue de l’ensemble du crédit. En outre, la politique monétaire est susceptible de modifications dans un délai rapide, en fonction des choix des responsables. Enfin, les conjoncturistes sont loin d’être d’accord sur l’interprétation des mouvements de ces indicateurs…
Pour expliquer leurs erreurs, les prévisionnistes ont encore d’autres arguments à faire valoir. En ce qui concerne les prévisions officielles, si certaines ne se réalisent pas, c’est tout simplement parce qu’il s’agit de pieux mensonges. Dans un passé récent, des ministres n’ont-ils pas affirmé que le dirham ne serait pas dévalué, alors même que leurs services préparaient d’arrache-pied ladite opération ? Mais il était essentiel qu’elle ne soit pas (trop) anticipée par les marchés. De même, quand l’inflation était forte, la hausse des prix constatée, a posteriori, était toujours supérieure à celle annoncée par le gouvernement dans ses prévisions. Cette sous-estimation délibérée, mais quand même vraisemblable, était censée éviter un effet d’annonce qui aurait incité les salariés à demander une hausse de salaire au moins égale au taux d’inflation officiellement prévu. Les prévisions de déficit budgétaire sont aujourd’hui traitées sur un mode analogue, cette fois-ci pour éviter de faire peur inutilement «aux marchés financiers». En fait, la principale limite de la pratique des prévisionnistes vient de leurs instruments de travail : les modèles macroéconomiques. Les principaux organismes de prévision sont dotés de ces instruments. Ailleurs, ces modèles macroéconomiques sont en vogue. Ils permettent en effet d’assurer aux prévisions une cohérence globale. A cela s’ajoute un parfum de scientificité apporté par l’usage de méthodes statistiques de plus en plus élaborées pour l’estimation des relations. Chez nous, c’est la grande déception. Beaucoup de ressources ont été utilisées dans la confection de ces modèles. Qui se souvient du programme Nour ? Ce modèle annoncé en grande pompe. Il s’est éteint à la fleur de l’âge. Qui se souvient aussi des modèles construits avec l’appui financier et technique de l’Union Européenne, du Canada et d’autres pays. On ne sait rien de l’usage qui en est fait. Les modèles ont en effet besoin, pour fonctionner, de données dites exogènes, concernant par exemple la politique budgétaire, la fiscalité. Or, il est toujours difficile d’obtenir ces données fines, même si l’on est membre de la famille. Les résultats obtenus peuvent varier du tout au tout, selon la pertinence des valeurs choisies pour ces données. Ensuite, les relations introduites dans ces modèles sont estimées sur une période assez longue, dix ou vingt ans. Or, les séries longues et homogènes sur une série de variables ne sont pas toujours disponibles. Et que sait-on des comportements des agents économiques, ménages, entreprises institutions ? Le suivi des comportements est nécessaire surtout qu’ils ont beaucoup évolué. Enfin, l’influence des économies étrangères est devenue déterminante. La situation de l’économie marocaine est fortement influencée par celle des autres économies, notamment européennes. On a encore des difficultés à mesurer cette demande adressée au Maroc, devenue, pourtant, si fortement explicative de la conjoncture dans le langage des prévisionnistes. Toutes ces raisons font que l’étoile des modèles au Maroc est plutôt pâle. Ils restent néanmoins utiles. Un retour sur cet art, parfois tout en nuances, doit se faire par ceux qui le pratiquent. Pour affiner ses méthodes et amorcer un recentrage quant à ses objectifs.
A lire aussi :
Chronique de Hinde TAARJI : "Le poids des mythes"
