Idées
Revenus : la zone d’ombre s’éclaircit
Aujourd’hui, le HCP pénètre en profondeur le monde
des revenus en livrant
les résultats de ses investigations sur l’état observé de la répartition personnelle. Cette amélioration de nos connaissances sur les faits permettra une modification sensible des attitudes sociales à l’égard des inégalités de revenus
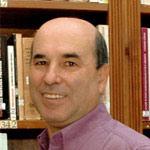
L’inconnu bordait le monde des revenus au Maroc. A cause de l’insuffisance des données statistiques et du flou qui les caractérisait. Avec la nouvelle enquête du Haut commissariat au plan (HCP), nous entrons dans ce monde obscur, armés d’une connaissance statistique qui pourrait répondre à la demande sociale d’analyse des phénomènes d’inégalités. En matière d’information, d’abord, nous ne disposions que de données agrégées relatives à des types de revenus (masse des salaires ou revenus des entreprises, par exemple) avec un minimum de détails sur leur structure interne, sauf pour les salaires dans une certaine mesure. Notre ignorance était le plus souvent totale sur la répartition des revenus de toute nature entre individus (ou ménages) considérés par référence soit à leur position dans la hiérarchie des revenus dans l’ensemble de la population – répartition dite «verticale» -, soit à leur appartenance à des groupes sociaux ou socio-économiques spécifiques – répartition dite «horizontale». Le manque de données précises sur la répartition personnelle des revenus justifiait ainsi, dans une certaine mesure, l’insuffisance d’une politique de redistribution de revenus systématiquement négligée, pendant longtemps.
Aujourd’hui, le HCP pénètre en profondeur le monde des revenus en livrant les résultats de ses investigations sur l’état observé de la répartition personnelle. Cette amélioration de nos connaissances sur les faits permettra une modification sensible des attitudes sociales à l’égard des inégalités de revenus qui est, sans doute, un facteur important dans la détermination de l’orientation des politiques sociales. Les principaux intérêts politiques et matériels qui divisent la société marocaine se sont longtemps fort bien accommodés de l’obscurité qui régnait sur ce sujet. D’un point de vue politique, d’abord, il était beaucoup plus sûr, pour les uns, de «prouver» la réduction des inégalités par l’augmentation du nombre des foyers détenteurs d’une voiture ou d’un réfrigérateur et, pour les autres, de «démontrer» le contraire en mettant en relief les profits de telle ou telle grande société que de prendre le risque de confronter directement et rigoureusement la répartition des revenus observée aux idées préconçues que l’on avait sur son état et son évolution. Quant aux groupes sociaux en rivalité pour le partage du gâteau national, aucun n’était certain d’avoir intérêt à ce que les situations de revenus de leurs membres soient exactement connues. L’opinion publique, cependant, semble exiger aujourd’hui de plus en plus autre chose que des généralités imprécises fondées sur des statistiques dépourvues de signification. Elle paraît même se lasser des versions simplifiées et déformantes dont elle a dû longtemps se contenter pour interpréter les impressions en matière de répartition des revenus.
La caractéristique majeure de la nouvelle enquête du HCP sur les revenus est de concerner cette répartition interin-dividuelle (ou personnelle) des revenus dont les données disponibles jusqu’à présent étaient incapables de rendre compte directement. C’est sur les revenus comparés des médecins, des petits exploitants agricoles, des ouvriers, des cadres, des PDG, etc., ou sur la situation respective des plus pauvres et des privilégiés de la fortune que portera le débat et non sur le partage global salaires-profits qui n’est qu’un aspect, important d’ailleurs, du problème général de l’inégalité. En mettant l’accent sur la répartition du revenu national entre ce qui revient à chaque grande catégorie de facteurs de production, les approches fonctionnelles de la répartition tendent à n’envisager les situations concrètes des individus que sous l’angle très partiel de la seule nature générale du facteur détenu par eux à titre principal. Il était peut-être possible il y a quelques temps, à titre d’approximation, de considérer que chaque individu ne possédait qu’un seul type de facteur, que les différences de situations individuelles entre propriétaires d’un type donné de facteur (par exemple, entre les diverses catégories de salariés) étaient négligeables et que les revenus issus de la propriété de ces facteurs constituaient la totalité des ressources de chacun. Mais il est clair que cette approche nécessaire pour passer, de manière à peu près fidèle, de la répartition fonctionnelle à la répartition personnelle est trop loin de correspondre aujourd’hui à la réalité pour que l’on puisse se contenter de raisonner sur des bases d’agrégats macro-économiques. Cette approche ne pouvait rien nous dire sur l’origine des facteurs détenus: ce qui fait qu’un individu qui a un capital physique ou humain de telle ou telle valeur est totalement négligé par elle alors que la question de la transmission héréditaire des inégalités est, à juste titre, considérée comme l’une des plus importantes à étudier dans ce domaine. Souhaitons que cette curiosité nouvelle pour les faits de répartition ne soit pas que provisoire, fruit d’un intérêt passager pour une des facettes des inégalités dans notre pays. La diffusion de l’information sur ce sujet, avec les besoins d’actualisation qu’elle fait naître automatiquement, est, dans une société qui attache une priorité à la cohésion sociale un phénomène irréversible et représente l’une des conditions fondamentales du maintien de la question des inégalités de revenus au premier plan de l’actualité.
