Idées
La santé, malade de ses conflits
La stratégie de divers gouvernements face au corps médical a été de diviser pour régner. Il en est ainsi du clivage entre médecins libéraux et médecins publics, entre généralistes et spécialistes. Fragmentée, la communauté médicale voit son statut se banaliser
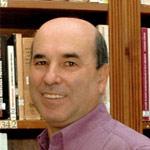
Parmi tous les enjeux sociaux, la santé est primordiale, car elle touche l’ensemble des Marocaines et des Marocains dans leur vie quotidienne. Ces derniers mois, l’économie de la santé connaît une agitation peu ordinaire. Deux conflits opposent le corps médical à l’Etat : la révision des tarifs de référence de l’Amo et l’ouverture du capital des cliniques à des investisseurs extérieurs à la profession. L’enjeu de ces conflits : des projets ou des mesures qui risquent d’éroder la compétence décisionnelle et le pouvoir du corps médical. A ces décisions, les médecins opposent l’argument éthique, présenté comme le rempart nécessaire à la défense des intérêts du patient et de la qualité des soins.
Les médecins privés et les cliniques menacent de rompre les conventions établies avec l’Agence nationale de l’assurance maladie. La gestion des tarifs de référence semble la cause de ce bras de fer entre l’organisme de régulation et le corps médical. Sur un fond imprégné du flou du partage des responsabilités, de méfiances et de désaccords entre les partenaires, le poids des habitudes a freiné l’action. Ce qui signifie que l’essentiel reste à faire. C’est-à-dire d’établir un cadre de conventionnement clairement défini, respectueux des droits et des obligations des parties, d’améliorer les pratiques de concertation, de réviser les tarifs de référence selon les normes convenues. Cela demandera beaucoup de temps et de persévérance : il faut que les partenaires s’approprient, individuellement et collectivement, les outils d’une gestion rigoureuse du système des conventions. La lutte contre les dysfonctionnements dans notre système de santé est une exigence qui provient des fondements mêmes de la déontologie médicale : la solidarité a pour corollaire une responsabilité accrue de tous les acteurs, décideurs publics comme professionnels de santé. Aussi, me paraît-il indispensable de faire prendre conscience à ces acteurs de la fragilité de notre système de couverture des soins qui n’est qu’à ses premiers pas. C’est à ces conditions que le Maroc pourra construire une médecine accessible à tous ses citoyens dans l’égalité et l’équité, chacun cotisant selon ses moyens et étant soigné selon ses besoins.
Sur un autre registre, le ministère de la santé prépare un projet de loi qui préconise une ouverture du capital des cliniques à des investisseurs autres que les médecins. Il considère que le projet peut contribuer au renforcement des infrastructures médicales privées et à l’amélioration de la qualité des soins. A l’opposé, parce que la santé est à la fois individuelle et collective, le corps des médecins défend l’idée que la profession doit pouvoir organiser elle-même ses services de santé, faisant ainsi prévaloir la «logique de métier» au profit d’une «logique de valeur». A entendre le corps médical, derrière cette ouverture se profile la tentative de mainmise du capital privé ou des groupes financiers sur les professions de santé. C’est la remise en cause de l’indépendance des praticiens. C’est l’ingérence inévitable de ces propriétaires dans l’organisation et la dispensation des soins, en vue de réaliser leurs objectifs de rentabilité financière. C’est la disparition progressive de l’exercice libéral des professions de santé, en faveur d’un exercice uniquement salarié. En somme, les médecins font valoir que les sociétés d’exercice libéral des professions de santé doivent rester entièrement contrôlées par les professionnels. Or, cette ouverture du capital est un alignement standard sur des pratiques internationales. De plus, plusieurs conditions peuvent être formulées dans le texte de loi pour éviter des dérives préjudiciables, notamment l’obligation de rester un nombre d’années minimum au capital, la réservation de la majorité des droits de vote aux instances délibératives aux médecins exerçant dans la structure et des restrictions dans les investissements dans certaines cliniques spécialisées. Le pouvoir d’opposition des médecins à ces deux mesures et projets est légitimé par la composante éthique de leur activité. Le pouvoir de la puissance publique relève de l’exigence d’un contrôle de la politique de la santé. D’un côté, l’affirmation de valeurs éthiques conduit les professionnels de santé à revendiquer une certaine autonomie et des droits d’autorégulation. Or, dans la pratique médicale, l’opposition entre considérations éthiques et considérations marchandes n’est pas aussi tranchée qu’il n’y paraît au premier abord. D’un autre côté, l’intervention publique n’est pas toujours soucieuse de transparence, de rigueur, d’équité et de justice. Nous ne citerons que la tolérance de l’Etat face à la gestion laxiste du temps plein aménagé et à la concurrence déloyale pratiquée par des cliniques-fondations. La stratégie de divers gouvernements face au corps médical a été de diviser pour régner. Il en est ainsi du clivage entre médecins libéraux et médecins publics, entre généralistes et spécialistes. Fragmentée, la communauté médicale voit son statut se banaliser. Les débats internes à la profession ont lieu aujourd’hui sur la place publique. Peut être parce que la santé, plus encore que l’enseignement ou la justice, est devenue l’affaire de tous.
A lire aussi :
Chronique de Hind TAARJI : "Un nouveau souffle"
Chronique de Najib REFAIF : "Autour de la musique"
