Idées
Marcher sur ses deux pieds
Le socle de la croissance économique est constitué de la consommation des ménages. Au Maroc, avec près de 400 milliards de dirhams, elle représente plus de la moitié (58 %) du PIB.
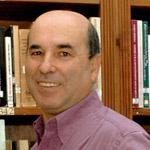
Pour l’économie marocaine, 2009 ne sera pas l’année d’un net coup de frein, comme c’est le cas dans la plupart des pays du globe. Le taux de croissance prévu est relativement soutenu : entre 5 et 6%. Mais la progression des exportations va ralentir. Ce ralentissement, sous le choc de la crise mondiale, amène à se demander si la croissance marocaine repose plutôt sur une dynamique interne ou externe. La question est d’autant plus sensible que les exportations s’étaient jusque-là attribué le mérite des bonnes performances de ces dernières années. Cette baisse de régime des exportations tord le cou à un cliché, selon lequel le Maroc, grâce à son insertion dans le marché mondial et ses liens étroits avec l’Union européenne (presque deux tiers de ses exportations), serait peu vulnérable aux soubresauts de la demande interne, plus particulièrement de la consommation des ménages.
La réalité nuance ces discours simplistes. Le socle de la croissance économique est constitué de la consommation des ménages. Au Maroc, avec près de 400 milliards de dirhams, elle représente plus de la moitié (58 %) du PIB. Contrairement à des discours répandus, ces dépenses de consommation sont peu liées à l’état d’esprit du moment. La fameuse «confiance», si souvent invoquée par les sondages, peut provoquer des effets de relance durant quelques mois ou, quand elle se transforme en défiance, alimenter une épargne de précaution temporaire. Attention tout de même, les pics de récession ou de reprise sont nettement plus marqués pour la consommation que pour l’investissement. Une petite variation des dépenses des ménages peut avoir des effets importants sur la croissance, par un effet de masse (la consommation représente près de deux fois l’investissement). De plus, la pluviométrie affecte une composante importante de la consommation : celle des ménages ruraux. Mais à moyen terme, c’est le niveau de vie qui détermine le niveau des dépenses. Autrement dit, les ventes de parapluies s’accroissent quand il pleut, mais la grande masse des dépenses (l’alimentaire, les loyers, les charges liées au logement, au transport, etc.) se reproduisent assez régulièrement.
Le marché intérieur est donc un atout pour le Maroc dans la mondialisation. Pour ses citoyens comme pour ses entreprises. Et pas seulement en période de crise où l’on redécouvre ses vertus. Facteur essentiel de compétitivité et d’emploi, sa croissance doit ainsi favoriser la convergence, la confiance et renforcer la capacité à agir du Maroc dans un contexte globalisé. Le marché intérieur constitue également le meilleur atout des PME pour être compétitives sur les marchés mondiaux: il leur permet d’atteindre la masse critique nécessaire de consommateurs et d’accéder aux input (ou intrants) nécessaires, y compris les capitaux, ou du moins, il devrait le leur permettre. Si l’apport du marché intérieur à la croissance est considérable, des carences importantes limitent son potentiel. D’un côté, les entreprises marocaines souffrent de sa petite dimension, de sa forte concentration, de son manque de transparence, de ses réglementations tatillonnes. Autant de facteurs handicapants qui limitent les économies d’échelle et les synergies et introduisent des barrières à l’entrée sur les marchés. De l’autre, les citoyens marocains n’ont pas suffisamment confiance dans les produits d’origine nationale. Ils ne sont pas incités, en l’absence d’un cadre réglementaire fiable, de porter leurs choix sur l’offre locale. Aussi, la production nationale progresse moins fortement que les importations. Les parts de marché des entreprises marocaines dans la demande interne se rétrécit. Le taux de pénétration des produits étrangers est sensible. Pas seulement pour les grandes marques. La grande distribution élargit les choix et a un effet sur le comportement du consommateur. Cet effet n’est pas toujours bénéfique à l’offre locale. D’où l’exigence d’un renforcement de la convergence du marché intérieur avec les normes internationales et d’un niveau élevé de protection des consommateurs. D’où aussi la nécessité d’une stratégie de riposte des producteurs locaux pour préserver ou améliorer leurs parts de marché. Cependant, pour croître plus vite, l’économie marocaine doit également jouer une stratégie de développement de l’offre exportable et d’amélioration qualitative de son insertion internationale, c’est-à-dire de formation, de recherche, d’innovation et d’investissement, avec pour aboutissement un élargissement de la gamme des produits et une amélioration de leur qualité. C’est reconnaître le rôle, dans la compétitivité internationale, de l’innovation et du progrès technique. Dans ces domaines, les politiques menées ne peuvent être que de long terme. En attendant, vu la netteté de la panne conjoncturelle au niveau mondial en 2009, une politique axée sur la demande intérieure a encore du bon. En somme, il faut savoir «courir sur ses deux jambes», comme disait Mao Tsé-Toung. Il faisait référence au modèle de développement chinois bien campé sur les deux piliers, l’agriculture et l’industrie. Un modèle en rupture avec le schéma de développement soviétique en déséquilibre s’appuyant sur l’industrie lourde. En ces moments de crise et dans ce cas précis du lien entre marché intérieur et marché extérieur, la pensée du Grand Timonier garde toujours son bon sens. Car une économie unijambiste ne peut soutenir les courses de vitesse de la compétition mondiale, ni tenir le souffle des épreuves marathoniennes de la durabilité.
