Idées
Investissement et emploi : je t’aime moi non plus
La distribution de la taille des entreprises marocaines tend à être dominée par la micro-entreprise. Cette situation peut s’expliquer par la difficulté qu’éprouvent les petites entreprises à se développer et franchir le seuil des 20 employés
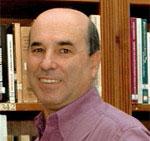
L’investissement est le moteur principal de la création d’emploi. Cette idée communément admise comporte une bonne part de vérité, mais, entre investissement et emploi, le lien n’est ni direct ni mécanique. Au cours des cinq dernières années, le Maroc a été un des meilleurs élèves de la classe des pays émergents en termes d’investissements : le taux de formation brut de capital fixe s’est établi à 20% du PIB par an en moyenne entre 2000 et 2006 alors qu’il se situait à 15% dans les années 90. Le taux d’investissement moyen des pays émergents est de l’ordre de 15% pour la même période. Selon les données d’une enquête récente sur le climat des investissements au Maroc, sur 21 pays pour lesquels les données sont disponibles, le Maroc se classe en troisième position après la Chine et la Corée du Sud. L’investissement du secteur privé affiche une croissance accélérée, qui est passée de 3,5% dans les années 90 à 6%. Le taux d’investissement réalisé par le secteur privé marocain est nettement supérieur à celui qu’on observe en Turquie, Tunisie ou au Chili.
Mais cette prouesse n’a pas pour autant réduit le chômage. L’emploi a en effet progressé moins vite que partout ailleurs. Le nombre d’emplois créés par la dynamique de l’investissement est insuffisant pour résorber le niveau élevé du chômage et accueillir les nouveaux entrants sur le marché du travail. Entre 2000 et 2007, environ 660000 emplois ont été créés en milieu urbain, soit en moyenne 100 000 par an. Bien que le taux de chômage urbain ait baissé ces dernières années, il reste supérieur à 15% pour l’ensemble des actifs et à 30% pour les jeunes diplômés. Cette amélioration a été facilitée par une réduction tendancielle du taux d’activité qui est passé de 50% en 1996 à 44,8% en 2006. De nombreux chômeurs sont sortis de la population active par découragement, ou ont retardé leur entrée sur le marché de l’emploi. La réduction récente du taux de chômage n’offre donc qu’une image partielle de la performance du marché du travail. Le taux d’emploi, mesurant la part des personnes employées dans la population de plus de 15 ans, révèle même une situation plus préoccupante. En milieu urbain, il est estimé à 38% en 2006, alors qu’il était supérieur à 40% dans les années 90. Le taux d’emploi au Maroc est donc très faible au regard de l’expérience internationale. La population employée au Maroc ne représente que 46% de la population âgée de 15 ans et plus (37,8% en milieu urbain). Dans les pays émergents, elle s’établit en moyenne à 55%.
L’économie marocaine n’est pas une «machine à créer de l’emploi». Il faut reconnaître que la croissance a été particulièrement économe en travail. Serait-elle, comme disent les économistes, une croissance plus intensive qu’extensive? Dans le jargon des économistes, ce qualificatif signifie que, pour alimenter les feux de la croissance, il faut moins de bras supplémentaires. Dit autrement : les gains de productivité, c’est-à-dire l’augmentation de production engendrée par l’efficacité croissante du personnel, seraient plus élevés que par le passé. Le capital chasserait-il le travail et la machine se substituerait-elle au travailleur, comme pourraient le penser certains? Certes, la croissance s’est appuyée sur une quantité croissante de capital : bâtiments, machines ou logiciels. C’est vrai dans le cas de l’industrie : bien qu’elle ait perdu de ses salariés, elle produit plus en volume. Mais, dans les activités de services (commerce, télécommunications, maintenance, conseil…), pour faire face à une activité en croissance, il a fallu embaucher plus de salariés. Parmi les emplois créés en milieu urbain entre 2000 et 2007, 95% l’ont été dans le secteur des services et de la construction, et seulement 5% dans le secteur manufacturier. L’emploi industriel connaît une quasi-stagnation depuis le début des années 2000.
L’explication ne réside pas dans l’évolution de la productivité, contrairement à ce qui pourrait être avancé. Pour que les potentialités théoriques d’emplois que recèlent les investissements puissent s’exprimer, il faut en effet une plus grande vitalité dans la création d’entreprises et l’entreprenariat. Deux conditions qui semblent plutôt se dégrader dans l’environnement actuel. Le processus de création d’entreprises présente des signes de ralentissement depuis quelques années. Il est plus dynamique dans les services et l’immobilier mais se ralentit dans l’industrie. Le taux d’entrée tend à baisser, alors que le taux de sortie est relativement stable. La combinaison de ces deux effets a conduit à une diminution du nombre d’entreprises. Cela veut dire que le tissu industriel a de la peine à se renouveler. La distribution de la taille des entreprises marocaines tend à être dominée par la micro-entreprise. Cette situation peut s’expliquer par la difficulté qu’éprouvent les petites entreprises à se développer, à grandir, à franchir le seuil des 20 employés. Par ailleurs, l’entreprenariat s’oriente vers des activités faiblement productives. Les nouveaux entrepreneurs ont une attirance plus prononcée vers le secteur des services et se détournent de l’industrie. Les nouveaux industriels s’orientent de moins en moins vers l’exportation. Un grand handicap face aux enjeux de la concurrence et de la compétition. C’est encore plus vrai aujourd’hui, dans une économie ouverte. D’où les désillusions que risquent d’entraîner les enthousiasmes prématurés sur l’accroissement du taux de l’investissement.???
