Culture
L’histoire des juifs du Maroc
Dans «Une certaine histoire des juifs du Maroc», Robert Assaraf s’est livré à un travail monumental pour faire revivre et mettre en lumière le judaïsme marocain. Un livre passionnant, instructif et utile, dont le lecteur fera son miel, tant il fourmille de détails et d’anecdotes.
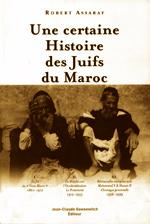
L’ on peut dénombrer plus de tombes au cimetière juif de Fès que de vivants juifs dans tout le Maroc : 2 000 à 3 000 personnes, estime-t-on, ultimes témoins d’une histoire qui s’évanouit vivement. Elle s’est écrite depuis l’époque romaine au moins, s’est étoffée avec l’arrivée des milliers de réfugiés expulsés par la «Reconquête» chrétienne. Mais un siècle, plus tumultueux que les autres, le XXe, a égaillé la communauté vers Israël, en Europe et en Amérique. Entre 1948, date de la création d’Israël, et 1956, année de l’indépendance du Maroc, plus de 90 000 juifs marocains choisirent souvent clandestinement de rejoindre la Terre sainte. Entre le prosélytisme de l’agence juive et les solidarités «panarabes», chaque conflit du Proche-Orient a crispé la société marocaine autour de la «question juive». Au lendemain de la guerre des Six jours (1967), l’émigration s’est accrue vers le Canada
ou la France. Le Maroc comptait
250 000 juifs en 1948 ; aujourd’hui la communauté a presque totalement disparu.
«Alors que, pour la première fois, les juifs marocains sont promus au rang de citoyens à part entière par deux Souverains particulièrement bien disposés envers eux, Mohammed V et Hassan II, ils choisirent d’émigrer massivement vers Israël, la France, le Canada, les Etats-Unis et l’Amérique du Sud. Cet exode sans précédent, qui connut certaines périodes de pointe, en 1956, au début des années soixante et après juin 1967, découlait tout aussi bien d’une réponse à l’appel sioniste et des conséquences de l’«arabisation» de la vie publique dans le cadre de la reconquête de l’indépendance que de l’implication grandissante du Maroc dans le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. Cette implication ayant entraîné l’interruption, durant de longues années, des liens du judaïsme marocain non seulement avec Israël mais aussi avec les grandes organisations juives qui l’avaient jusqu’alors «parrainé» et sur lesquels il s’appuyait, dans le passé, en période de crise», écrit Robert Assaraf dans le prologue d’Une certaine histoire des juifs du Maroc(*).
L’ouvrage comporte pas moins de 825 pages. Il forme ce qu’on appelle communément un «pavé». Le terme évoque généralement un écrit pesant, fastidieux, rébarbatif. Là rien de tel, Une certaine histoire… se lit comme un récit palpitant, auquel il est difficile de s’arracher tant qu’on ne connaît pas le fin mot de l’histoire. L’écriture en est élégante, rapide, prenante lorsque l’auteur de Mohammed V et les Juifs (1997) affronte les nombreux moments tragiques de la communauté juive marocaine, en évitant presque toujours le sel des larmes et les reflets tentateurs de la compassion. Sauf dans les passages, forcément subjectifs, où il se porte témoin, Robert Assaraf, en historien accompli, pose un regard distancié sur la mémoire du judaïsme marocain. Mémoire embrouillée, contradictoire et complexe, dont ce natif de Rabat, créateur, en 1996, du Centre international de recherches sur les juifs du Maroc et fondateur, en 1999, de l’Union mondiale du judaïsme marocain, démêle l’écheveau, de manière lucide, intelligente et argumentée.
La «dhimma», croix des juifs marocains
Découpé en trois parties (La fin du «Vieux Maroc» (1860-1912) ; La marche vers l’occidentalisation (1912-1955) ; Retrouvailles manquées avec Mohammed V et Hassan II (1956-1999), l’ouvrage déroule une fresque dépeignant une époque semée de sang et de larmes, de joies éphémères, de grandes espérances et de cruelles désillusions. Car, au Maroc, comme partout en terre d’Islam, les juifs traînent un boulet, censé les protéger : la dhimma accordée aux gens du Livre. Prescrite par le Coran, fixée par le Calife Omar et codifiée, au XIe siècle, par le juriste Al Mawedi, elle comporte douze règles, dont six ne peuvent être transgressées à aucun prix, sinon celui de la peine de mort. «Les six interdits sont les suivants : se moquer ou falsifier le Coran, parler en termes désobligeants ou insultants du Prophète ou de l’Islam, avoir des relations sexuelles avec une musulmane, tenter de détourner un musulman de sa foi, porter assistance à des infidèles en guerre contre les musulmans et se servir d’armes. Enfreindre les six autres règles n’exposait qu’à des sanctions et amendes diverses. Cette deuxième série d’obligations a pour objet de bien marquer l’infériorité des dhimmis et les empêcher d’exercer une influence sur les croyants. Ainsi en est-il de l’obligation de payer l’impôt de soumission, de porter un vêtement distinctif, de construire des lieux de culte ou d’habitation qui ne dépassent pas en hauteur ceux de leurs voisins musulmans, de ne pas se livrer publiquement à l’exercice de sa religion ou à la consommation d’alcool, d’enterrer ses morts sans faire entendre lamentations ou prières et, enfin, de ne point posséder ou monter des montures nobles comme le cheval».
Ce statut infériorisant va peser de tout le poids de ses contraintes sur le destin de la population juive marocaine. Les juifs vont connaître des hauts et des bas, selon que les Souverains l’appliquent à la lettre ou en émondent la sévérité. L’attitude de ceux-ci envers les juifs varie en fonction de leur esprit de tolérance, leur bon plaisir, leur opportunisme et leur sens de la diplomatie. Sidi Mohammed Ben Abdallah, sultan éclairé, n’exige des juifs que la jiziya, l’impôt de capitation, et jette du lest pour le reste. Mieux : il prend conseil auprès de nombreux juifs, en élit certains comme tajjar-es-sultan, à Mogador, avec des privilèges exceptionnels. Son successeur, Moulay Lyazid, en revanche, sème la terreur parmi cette communauté, en jurant de la faire passer par le fil de l’épée. S’il ne met pas ce funeste projet à exécution, il ne s’illustre pas moins par le pillage et le saccage qu’il ordonne des mellahs de Tétouan, El Ksar, Larache, Rabat, Taza et Meknès. A Oujda, il fait couper une oreille aux juifs afin qu’on puisse les distinguer des non-juifs. A Fès, il fait évacuer le mellah et détruire le cimetière juif, dont les pierres tombales servirent à la construction d’une mosquée.
Sous Moulay Slimane, la condition des juifs connaît une embellie. Avec Moulay Abderrahman, ce sera le chaud et le froid. D’un côté, les entreprises des négociants juifs seront favorisées. De l’autre, la dhimma sera rigoureusement appliquée.
Aujourd’hui, la communauté juive ne compte pas plus de 2 000 à 3 000 personnes
Mais, excepté la parenthèse de Moulay Lyazid, rapporte Robert Assaraf, la situation des juifs «ne s’était pas écartée de deux constantes. Au sommet, la bienveillance intéressée des sultans – à la fois chef politique et commandeur des croyants – envers les communautés juives au rôle économique incontournable. A la base, une symbiose sociale, économique et culturelle malgré l’infranchissable fossé religieux et la ségrégation de l’habitat». En somme, un équilibre entre les deux communautés, mais précaire, vulnérable, ténue. Les convoitises européennes d’un pays, jaloux de son isolement, vont en sonner le glas. A chaque soubresaut de l’histoire, les juifs seront traités en boucs émissaires, et, à ce titre, payeront un lourd tribut.
Après la défaite du Maroc à la bataille d’Isly en 1844, les juifs de Mogador sont pillés et massacrés par des tribus berbères des alentours. Ce n’est que le sanglant prélude d’un drame en plusieurs actes. Le plus orageux a pour décor la ville de Fès, où des émeutiers, en guise de protestation contre la signature du Protectorat, mettent à feu et à sang le mellah.
Bilan : des milliers de réfugiés, 45 morts, 23 hommes, 10 femmes et 12 enfants, une trentaine de blessés. Et le fossé entre les communautés musulmane et juive va s’élargir pendant la période coloniale, avec beaucoup de dégâts pour la seconde, «coupable» de faire le jeu de l’envahisseur, en épousant ses principes et ses convictions. De fait, au rebours de leurs compatriotes musulmans, les juifs acceptent l’occidentalisation, voire la favorisent et l’accélèrent. Mais cette volonté d’assimilation est brutalement brisée par le décret de Vichy du 2 juin 1941 fixant le nouveau statut des juifs. La législation raciale est appliquée scrupuleusement, jusqu’au 10 août 1942, date à laquelle feu Mohammed V y met fin, en déclarant intrépidement qu’«il ne saurait y avoir de différence entre ses sujets marocains musulmans ou juifs, et qu’en ces heures tragiques, il veillait plus particulièrement sur ses sujets juifs». Non seulement le Souverain s’oppose à l’application du «statut des juifs» mis en place par le gouvernement de Vichy, mais il accorde une pleine citoyenneté à la population juive après
l’indépendance, rompant ainsi avec l’ambiguë et infamante dhimma. Feu Hassan II, à son tour, affermit l’œuvre bienveillante de son père. D’où l’attachement indéfectible des juifs marocains à la monarchie.
Mais, par un paradoxe dont l’histoire n’est pas chiche, si le Maroc n’abrite plus qu’une poignée de juifs, le judaïsme marocain ne cesse de s’épanouir. Ils sont un million de juifs marocains, disséminés à travers le monde, qui entretiennent le feu grégeois de la judéité marocaine. Au point qu’on parle de «renouveau du judaïsme marocain»
